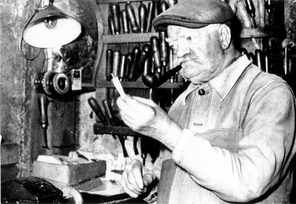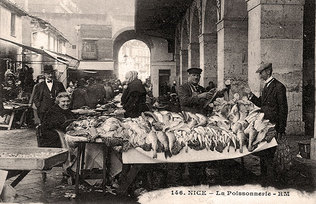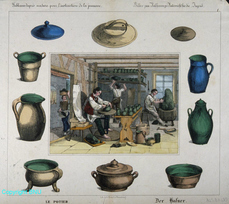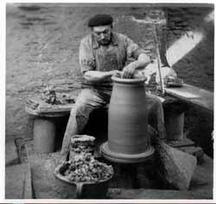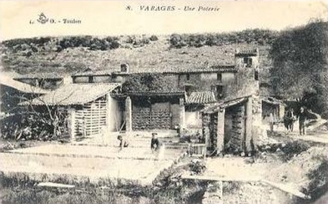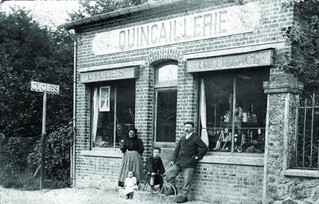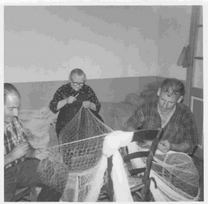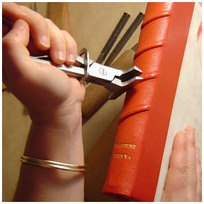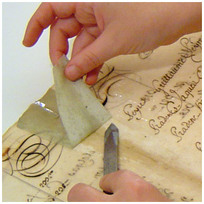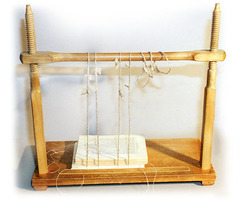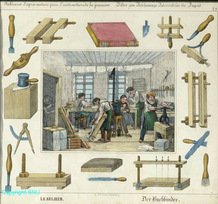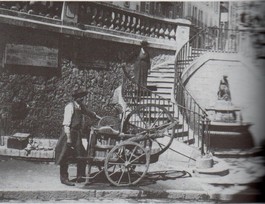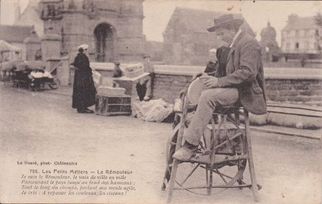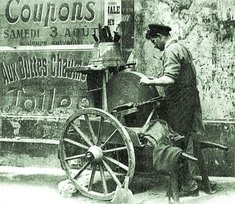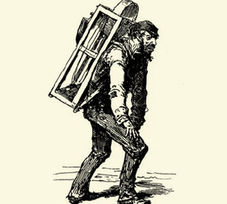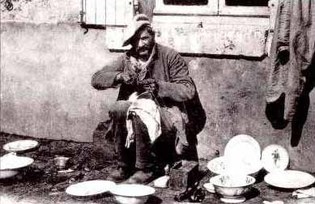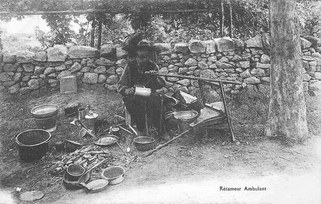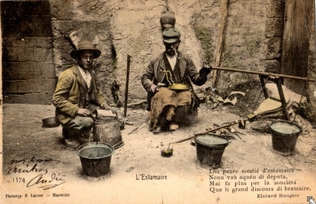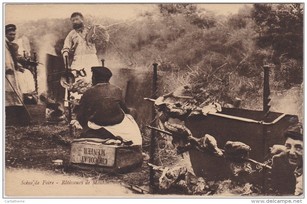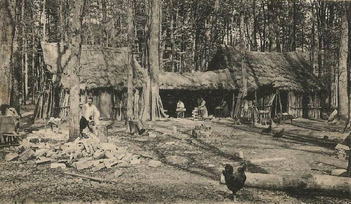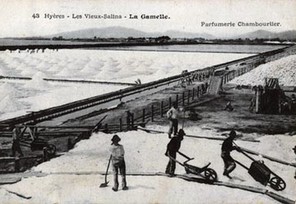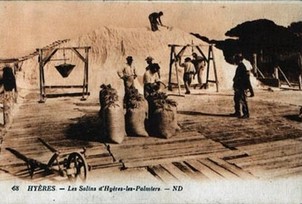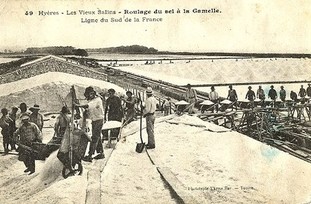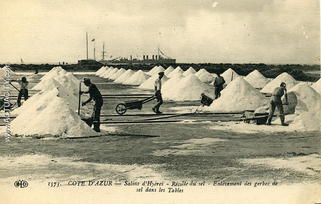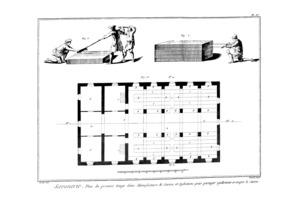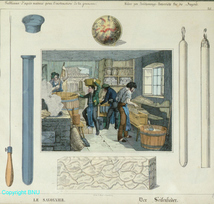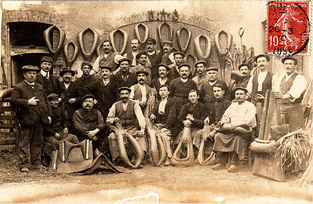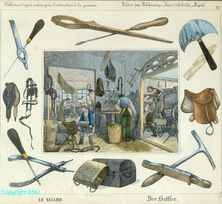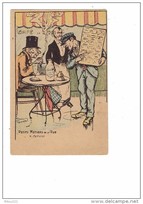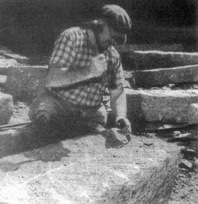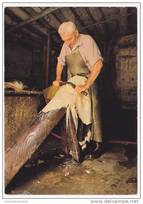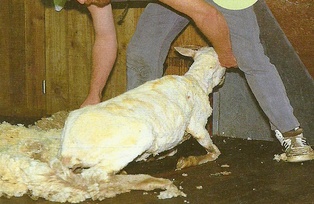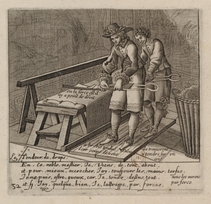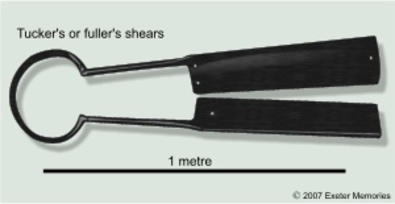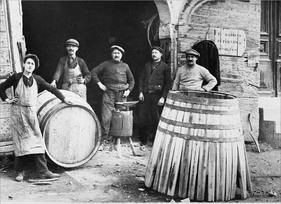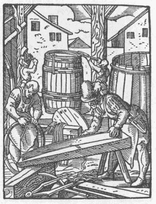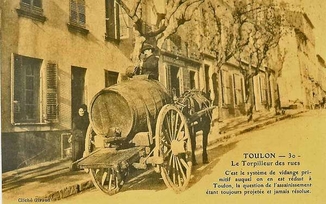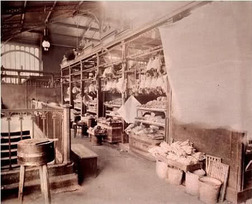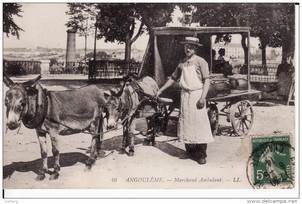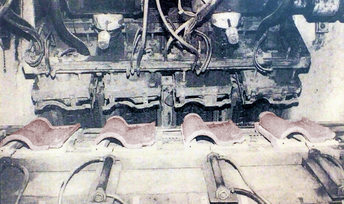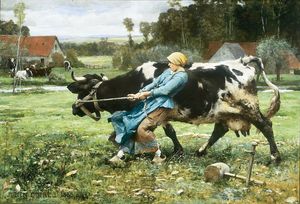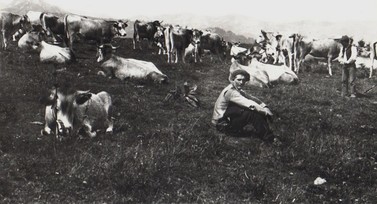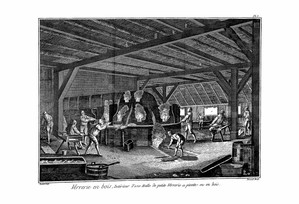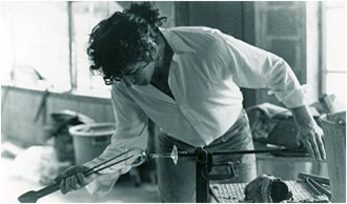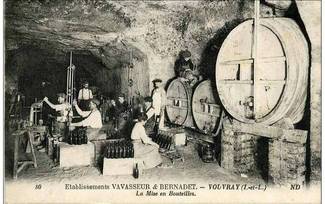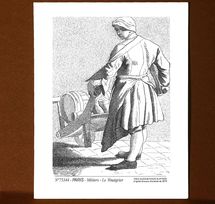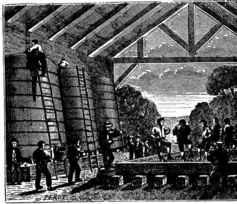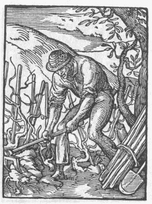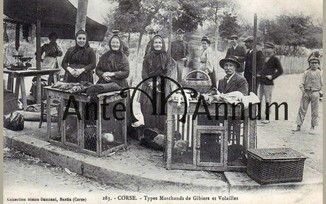Artisanat et Pratiques Commerciales - Liste des métiers par ordre alphabétique.
artisan accordant les instruments de musique : orgue, clavecin, piano, harpe, ...
Le travail principal de l’accordeur consiste à assurer « l’accordage », c’est-à-dire à accorder « juste » l’instrument qu’on lui soumet. L’accordeur travaille les sonorités de l’instrument de façon à lui donner les caractéristiques harmoniques voulues.
provenance du nom :
De 'accorder' - Du bas latin 'accordare'
thématiques associées : métier en rapport avec l'art artisanat
groupe d'activités : services
milieu de travail : milieu urbain milieu rural
Références >>



production légumière ou végétale, élevage agricole et aquacole, arboriculture et viticulture, élevage bovin ou équin
provenance du nom :
Du latin 'agricultor' de 'agri' (« de champs ») et 'cultor' (« cultivateur »)
thématiques associées : métier agricole
groupe d'activités : production agricole
milieu de travail : milieu rural
Présence dans le lieu d'exercice : permanente
organisation du travail : travail en groupe
Références >>



porteur d'eau (midi)
provenance du nom :
De l'occitan ‘aiga’, du latin ‘aquarius’ et ‘aqua’ - De l’indo-européen commun ‘akʷā’ (« eau »).
Un aiguier, en Provence, est aussi une citerne creusée dans la roche et voûtée de pierres, servant à recueillir les eaux de ruissellement.
Un aiguier, en Provence, est aussi une citerne creusée dans la roche et voûtée de pierres, servant à recueillir les eaux de ruissellement.
groupe d'activités : services
milieu de travail : milieu rural milieu naturel
Références >>

Personne qui fait les aiguillettes (cordons, rubans, etc., ferré par les deux bouts, pour servir à attacher, mais qui ne sert quelquefois que d’ornement) et les lacets.
Aiguillettes se faisait de bon cuirs. Q dater du XV-ème siècle, les aiguillettes jouent un grand rôle, surtout dans le costume masculin.
thématiques associées : ouvrier
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : métal
Références >>

marchand ou cultivateur d'ail
provenance du nom :
Mot composé de 'aille' et -ier - du latin 'alium'.
De l’indo-européen commun ālu- (« amer, poison ») qui donne aussi 'alum' (« Symphytum officinale »), 'helm' (« poison ») en albanais, ālukám- (« bulbe d’ognon ») en sanscrit.
thématiques associées : métier agricole
groupe d'activités : production agricole vente
milieu de travail : milieu urbain milieu rural
Modalités d'apprentissage : apprentissage par le travail
Références >>



Celui, celle qui fabrique des allumettes.
On fait les allumettes avec le bois sec, sans nœuds. Ils le font sécher au four, puis le coupent, selon la direction des fibres du bois en petites tablettes à laide d'une plane. ...
provenance du nom :
Provient du verbe 'allumer'. Ce nom commun a été créé en 1213 pour désigner des bûchettes qui servaient de petit bois pour démarrer le feu.
Du latin 'lumen' "lumière".
Du latin 'lumen' "lumière".
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : bois et écorces
Références >>
Wiktionnaire
L-B Francœur, François Étienne Molard, Louis Sébastian Lenormand, Pierre Jean Robiquet, M. Payen Dictionnaire technologique, ou Nouveau dictionnaire universel des arts et métiers, et de l'économie industrielle et commerciale [Éditeur : Paris, Thomine et Fortic, 1822-1835., pp. 197-199]
L'ALLUMETTIER
Massey Les AUTES - COPS "AUTREFOIS" [site Web]
L-B Francœur, François Étienne Molard, Louis Sébastian Lenormand, Pierre Jean Robiquet, M. Payen Dictionnaire technologique, ou Nouveau dictionnaire universel des arts et métiers, et de l'économie industrielle et commerciale [Éditeur : Paris, Thomine et Fortic, 1822-1835., pp. 197-199]
L'ALLUMETTIER
Massey Les AUTES - COPS "AUTREFOIS" [site Web]



Personne chargée d'allumer le soir et d'éteindre le matin les réverbères (au gaz) dans les rues des agglomérations.
provenance du nom :
Composé de ‘allumeur’ - (du latin populaire ‘alluminare’ – « enflammer ») et de ‘réverbère’ – (Dispositif pour réfléchir la lumière ou la chaleur).
thématiques associées : ouvrier
groupe d'activités : services
milieu de travail : milieu urbain
Présence dans le lieu d'exercice : permanente
Références >>

Celui qui qui cultive des amandiers pour la production d’amande.
thématiques associées : métier agricole
groupe d'activités : production agricole
milieu de travail : milieu rural
Modalités d'apprentissage : école (enseignement collectif),transmission père en fils ou mère en fille
Références >>

Dans les greniers à sel, employé chargé de mesurer (au minot) et de distribuer le sel.
provenance du nom :
Du mot 'hémine' - mesure de capacité, que à Paris représentait la moitié du setier, sois environ 78 litres.
Témoignage : Notre processus de fabrication fait la part belle à l’intervention humaine, au savoir-faire manuel, à l’œil expert de l’artisan. Le recours aux machines est limité : nous utilisons des outillages traditionnels en matière de forge, de gravure ou de polissage. Pour autant, le recours aux technologies modernes n’est pas exclu quand celles-ci s’allient au savoir-faire traditionnel pour améliorer la qualité de nos couteaux.
Pour fabriquer un couteau de A à Z, l’artisan coutelier doit maîtriser de multiples savoir-faire. De la forge à la finition, les étapes sont nombreuses et requièrent une expertise propre. Les principales étapes de la production sont la forge, le montage, l’ajustage, le sciage, le façonnage, le ciselage et le polissage.
La forge est la mise en forme du métal. L’acier est chauffé puis forgé par l’artisan pour fabriquer une lame robuste et tranchante. Une fois forgée, la pièce d’acier est de nouveau montée en température puis trempée dans un bain d’huile qui lui confère dureté et élasticité. Nous proposons plusieurs types d’aciers forgés : inox, carbone ou damas.
L’artisan coutelier prépare et ajuste les pièces métalliques du couteau que sont la lame, le ressort, les mitres et les platines. Le ressort forgé est la partie centrale du manche sur laquelle repose la lame lorsque le couteau est fermé. Le couteau est ajusté en position ouverte et fermée afin de garantir son parfait fonctionnement mécanique et le bon maintien de la lame dont le fil ne doit pas être en contact avec le ressort lors de la fermeture.
La fiabilité du couteau dépend de la précision de cet ajustage.
Les matériaux utilisés pour la fabrication des manches sont débités à la main. Nous proposons plusieurs types de matières : bois, cornes et minéraux. Nous n’achetons que des matériaux nobles, de première qualité. D’un couteau à l’autre, l’aspect du manche n’est jamais identique car chaque pièce de matière est unique. Le manche est façonné manuellement.
Le ciselage, aussi appelé guillochage, est l’opération par laquelle le coutelier sculpte les parties métalliques du couteau. Le ressort, les platines peuvent être ciselés. Dans le cas du laguiole, on sculpte aussi la mouche qui orne le ressort.
Le polissage donne son éclat au couteau et révèle la matière du manche. Avant d’être expédié, le couteau est affuté, contrôlé et nettoyé.
>
>
Références >>
D. Chatry Les Métiers de nos Ancêtres [consultation 08/11/2015]
P. Reymond DICTIONNAIRE des VIEUX METIERS. 1 200 METIERS DISPARUS OU OUBLIÉS
Alfred Franklin Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis le treizième siècle [avec une préface de M. E. Levasseur, H. Welter (Paris), 1906]
P. Reymond DICTIONNAIRE des VIEUX METIERS. 1 200 METIERS DISPARUS OU OUBLIÉS
Alfred Franklin Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis le treizième siècle [avec une préface de M. E. Levasseur, H. Welter (Paris), 1906]

Un amoulageur est un spécialiste de la construction des roues à aubes pour moulin à eau. L'amoulageur mobilise des connaissances en maçonnerie, métallurgie, hydraulique, mécanique, charronnage, charpenterie.
thématiques associées : métier en rapport avec le bâtiment
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
Modalités d'apprentissage : école (enseignement collectif),compagnonnage
Références >>



personne qui conduit des ânes,
personne qui loue des ânes pour les excursions des promeneurs,
personne qui loue des ânes pour les excursions des promeneurs,
thématiques associées : métier animalier
groupe d'activités : services
milieu de travail : milieu naturel milieu urbain milieu rural
Références >>



Personne qui élève des abeilles.
provenance du nom :
Du latin 'apis' (abeille), avec le suffixe -culteur.
thématiques associées : métier animalier
groupe d'activités : production agricole
milieu de travail : milieu urbain milieu rural milieu naturel
Témoignage : "Le soin aux abeilles, s'étend de la mise à disposition d'un environnement correct, du choix de l'emplacement du rucher à la lutte contre les maladies et les prédateurs. Les abeilles ont un nouvel ennemi : le frelon asiatique. Pour l'empêcher d'entrer dans la ruche, je mets une porte avec un réducteur. Lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises, je dois nourrir les abeilles. Je leur apporte un sirop composé de 50 % de sucre et 50 % d'eau que j'introduis par un nourrisseur avec un système d'abreuvoir à l'intérieur de la ruche. Je constitue aussi de nouvelles colonies pour renouveler l'élevage. Mes journées sont longues et mes vacances, courtes. Toutefois, je peux faire appel à un service de remplacement composé d'agriculteurs ou à des connaissances, par exemple d'anciens stagiaires. Ce qui me passionne dans ce métier, c'est le fonctionnement de la communauté des abeilles. Leur mode de communication par phéromones et contact des antennes reste mystérieux."
>Yves, apiculteur dans la région de Grenoble (38)
>Yves, apiculteur dans la région de Grenoble (38)



Spécialiste des arbres (fruitiers, d'ornement ou forestiers). L'arboriculteur plante, entretien et soigne les arbres, sélectionne des variétés selon leur fonction (produire des fruits, décorer, reboiser), les terrains, le climat et les autres essences d'arbres déjà présentes ou à venir.
provenance du nom :
Du latin 'arbor', « arbre » avec le suffixe -culteur, « celui qui cultive »
groupe d'activités : production agricole services
milieu de travail : milieu urbain milieu rural
Références >>



fabricant ou commerçant d'armes et de moyens de défense
Au Moyen Age, l'armurier fabrique des armures (on disait aussi armurier heaumier). Le statut des armuriers est créé en 1407. Avec l'évolution de l'armement, il fabrique des armes blanches ou à feu, en compétition avec les fourbisseurs et les arquebusiers. Aujourd'hui, un armurier est une personne qui répare, modifie, conçoit ou fabrique des armes à feu en suivant les spécifications de l'usine ou du client, en utilisant des outils à main ou des machines. Les heaumiers, du nom du heaume, l'une des pièces principales de l'armure, fabriquaient plus particulièrement des armes défensives, telles que cuirasses, casques, brassards, etc. Les arquebusiers fabriquaient dans le principe des arquebuses; ils confectionnèrent par la suite des fusils, des pistolets et toutes armes propres à lancer des projectiles. Enfin les fourbisseurs fabriquaient les armes blanches, telles qu'épées, lances etc.
Au Moyen Age, l'armurier fabrique des armures (on disait aussi armurier heaumier). Le statut des armuriers est créé en 1407. Avec l'évolution de l'armement, il fabrique des armes blanches ou à feu, en compétition avec les fourbisseurs et les arquebusiers. Aujourd'hui, un armurier est une personne qui répare, modifie, conçoit ou fabrique des armes à feu en suivant les spécifications de l'usine ou du client, en utilisant des outils à main ou des machines. Les heaumiers, du nom du heaume, l'une des pièces principales de l'armure, fabriquaient plus particulièrement des armes défensives, telles que cuirasses, casques, brassards, etc. Les arquebusiers fabriquaient dans le principe des arquebuses; ils confectionnèrent par la suite des fusils, des pistolets et toutes armes propres à lancer des projectiles. Enfin les fourbisseurs fabriquaient les armes blanches, telles qu'épées, lances etc.
provenance du nom :
Armure. On a dit aussi dans l'ancien français 'armoyer', de l'ancien verbe 'armoier'.
Du latin 'armatura' (« ensemble des armes », « armure du soldat »).
Du latin 'armatura' (« ensemble des armes », « armure du soldat »).
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : réparation vente fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : métal bois et écorces
Références >>

marchand de lard
provenance du nom :
De l’ancien bas vieux-francique 'bako' « lard, coupe du flanc de porc ».
groupe d'activités : vente
Références >>

Tenancier ou employé des bains publics.
Dans les étuves urbaines, on ne fait pas que se laver, transpirer et se relaxer au chaud. Les étuveurs donnent aussi à manger et à boire aux baigneurs sur des planches de bois permettant ainsi de consommer tout en demeurant dans l'eau. Ces étuves, comme les tavernes, sont des lieux de grande sociabilité.
provenance du nom :
De 'baigner' - en ancien français 'bagner', plus tard refait en 'baigner' d’après bain. Du latin 'balneare', altéré en latin populaire en 'baneare'.
groupe d'activités : services
Témoignage : Notre processus de fabrication fait la part belle à l’intervention humaine, au savoir-faire manuel, à l’œil expert de l’artisan. Le recours aux machines est limité : nous utilisons des outillages traditionnels en matière de forge, de gravure ou de polissage. Pour autant, le recours aux technologies modernes n’est pas exclu quand celles-ci s’allient au savoir-faire traditionnel pour améliorer la qualité de nos couteaux.
Pour fabriquer un couteau de A à Z, l’artisan coutelier doit maîtriser de multiples savoir-faire. De la forge à la finition, les étapes sont nombreuses et requièrent une expertise propre. Les principales étapes de la production sont la forge, le montage, l’ajustage, le sciage, le façonnage, le ciselage et le polissage.
La forge est la mise en forme du métal. L’acier est chauffé puis forgé par l’artisan pour fabriquer une lame robuste et tranchante. Une fois forgée, la pièce d’acier est de nouveau montée en température puis trempée dans un bain d’huile qui lui confère dureté et élasticité. Nous proposons plusieurs types d’aciers forgés : inox, carbone ou damas.
L’artisan coutelier prépare et ajuste les pièces métalliques du couteau que sont la lame, le ressort, les mitres et les platines. Le ressort forgé est la partie centrale du manche sur laquelle repose la lame lorsque le couteau est fermé. Le couteau est ajusté en position ouverte et fermée afin de garantir son parfait fonctionnement mécanique et le bon maintien de la lame dont le fil ne doit pas être en contact avec le ressort lors de la fermeture.
La fiabilité du couteau dépend de la précision de cet ajustage.
Les matériaux utilisés pour la fabrication des manches sont débités à la main. Nous proposons plusieurs types de matières : bois, cornes et minéraux. Nous n’achetons que des matériaux nobles, de première qualité. D’un couteau à l’autre, l’aspect du manche n’est jamais identique car chaque pièce de matière est unique. Le manche est façonné manuellement.
Le ciselage, aussi appelé guillochage, est l’opération par laquelle le coutelier sculpte les parties métalliques du couteau. Le ressort, les platines peuvent être ciselés. Dans le cas du laguiole, on sculpte aussi la mouche qui orne le ressort.
Le polissage donne son éclat au couteau et révèle la matière du manche. Avant d’être expédié, le couteau est affuté, contrôlé et nettoyé.
>
>
Références >>
D. Chatry Les Métiers de nos Ancêtres [consultation 08/11/2015]
Wiktionnaire
XX baigneur étuviste 18 ème siècle [Le blog de ancetres-metiers-conditions.over-blog.com]
P. Reymond DICTIONNAIRE des VIEUX METIERS. 1 200 METIERS DISPARUS OU OUBLIÉS
XX L'étuve au Moyen-âge
Le renoncement au corps [site "Secrets de Beauté, histoire de la cosmétique en France - BIU Santé, Paris"]
Wiktionnaire
XX baigneur étuviste 18 ème siècle [Le blog de ancetres-metiers-conditions.over-blog.com]
P. Reymond DICTIONNAIRE des VIEUX METIERS. 1 200 METIERS DISPARUS OU OUBLIÉS
XX L'étuve au Moyen-âge
Le renoncement au corps [site "Secrets de Beauté, histoire de la cosmétique en France - BIU Santé, Paris"]



artisan qui fait et vend des balances
provenance du nom :
(1590) Mot composé de balance et -ier. Apparaît au XIIIe siècle dans le sens de « fabricant de balances ».
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
travaille : bois et écorces métal
Références >>
Wiktionnaire
Idal Productions Matériel de pesage [Matériel de pesage, balance roberval, pesage professionnel, balances industrielles]
ARCOMA - Instruments de mesure - BALANCES ROMAINES XXe - XVIIe [L’Association pour la Recherche et la Conservation des Outils des Métiers de l'Artisanat (A.R.C.O.M.A.)]
Idal Productions Matériel de pesage [Matériel de pesage, balance roberval, pesage professionnel, balances industrielles]
ARCOMA - Instruments de mesure - BALANCES ROMAINES XXe - XVIIe [L’Association pour la Recherche et la Conservation des Outils des Métiers de l'Artisanat (A.R.C.O.M.A.)]

Personne chargé de nettoyer les rues.
provenance du nom :
De ‘balai’ - De l’ancien français ‘balain’ (« genêt à balais »), du gaulois ‘balatno’ « genêt » (cf. breton ‘alannen’ écossais ‘bealaidh’)
thématiques associées : ouvrier
groupe d'activités : services
milieu de travail : milieu urbain milieu rural
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)
Modalités d'apprentissage : apprentissage par le travail
Références >>



Personne qui coupe les cheveux et la barbe mais qui, avant le XVIIIe siècle (barbier chirurgien) effectue aussi les saignées, pose les ventouses, panse les plaies, etc.
provenance du nom :
Du latin ‘barba’ - de l’indo-européen commun ‘bʰardʰeh’ (« barbe »).
groupe d'activités : services
milieu de travail : milieu urbain milieu rural
Présence dans le lieu d'exercice : intermittente,permanente



vendeur d'objets divers de faible valeur
provenance du nom :
Du persan بازار, 'bâzâr' (« marché ») ou de l’arabe بازار, 'bâzâr' (« marché »)
groupe d'activités : vente

crieur public - profession généralement itinérante, sa fonction consiste à se promener dans la localité, s'arrêter à certains endroits (place publique, balcon de l'hôtel de ville appelé bretèche, carrefour, parvis des églises), annoncer sa présence par un appel sonore (tambour, clochette, trompette...) et commencer à lire son texte.
provenance du nom :
Du vieux-francique *bidil « messager de justice » ; en ancien français 'bedel'.
groupe d'activités : services communication
milieu de travail : milieu urbain milieu rural métier ambulant
Présence dans le lieu d'exercice : intermittente
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé) - En Basse-Bretagne jusqu'à la fin des années 1670, les crieurs se colportaient en criant les informations locales d'une ville, d'un village ou d'un hameau à l'autre, à la manière d'un véritable relais de transmission oral.
Références >>



homme qui dirige un troupeau de moutons,
personne qui garde les moutons mais aussi les oies, vaches, cochons et en général tous les animaux de la ferme quand ils sont dans les pacages et pâtures
provenance du nom :
En ancien français bergier et berchier (« gardien de moutons »). Du latin vulgaire berbicarius, dérivé de berbix.
thématiques associées : métier animalier
groupe d'activités : production agricole
milieu de travail : milieu naturel
Présence dans le lieu d'exercice : intermittente
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé) - souvent aidée par un chien de berger
Modalités d'apprentissage : école (enseignement collectif),apprentissage par le travail,auto-formation
Références >>



Personne qui fabrique des joyaux et plus largement des objets de parure mettant en valeur des pierres précieuses, des pierres fines, des pierres ornementales et des perles, en utilisant pour les montures des métaux précieux tels que l'or, l'argent le platine, voire le palladium et qui vend des bijoux.
provenance du nom :
(1460) Du breton 'bizoù' (« bague, anneau »), dérivé de 'biz' (« doigt »).
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
milieu de travail : milieu urbain
travaille : métal pierre, argile et matières rocheuses
Références >>

marchand de châtaignes
provenance du nom :
De 'bogue' - coque épineuse qui enveloppe la châtaigne ou marron
groupe d'activités : vente

Celui qui fait des boisseaux et divers ustensiles de bois servant au ménage.
A l'origine, le boisselier est fabricant de boisseau (ou boiceau, boesseau, bouesseau). Le boisseau était une mesure pour le grain et les légumes secs. Le boisseau a donné son nom aux boisseliers qui fabriquent non seulement des mesures de capacités en bois, mais aussi des tamis, des seaux, des brouettes, des bacs, des pelles, des lanternes, des pilons, des soufflets etc.
A l'origine, le boisselier est fabricant de boisseau (ou boiceau, boesseau, bouesseau). Le boisseau était une mesure pour le grain et les légumes secs. Le boisseau a donné son nom aux boisseliers qui fabriquent non seulement des mesures de capacités en bois, mais aussi des tamis, des seaux, des brouettes, des bacs, des pelles, des lanternes, des pilons, des soufflets etc.
provenance du nom :
De l’ancien français 'boissel' diminutif de 'boisse' (« mesure de blé dont le boisseau est le sixième »), lui-même du gaulois 'bost'a (« creux de main ») auquel est apparenté le breton 'boz' (« paume de la main »)
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : bois et écorces
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)
Références >>

Celui qui fabrique et vend des couvre-plats, garde-manger, corbeilles, etc. en tissus métalliques.
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
travaille : métal
Références >>

Ouvrier artificier pour les feux d'artifice.
Un artificier est un spécialiste chargé de la préparation et du tir d'un feu d'artifice. Il est aussi appelé pyrotechnicien. Il les conçoit, les prépare et les tire.
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
Témoignage : Notre processus de fabrication fait la part belle à l’intervention humaine, au savoir-faire manuel, à l’œil expert de l’artisan. Le recours aux machines est limité : nous utilisons des outillages traditionnels en matière de forge, de gravure ou de polissage. Pour autant, le recours aux technologies modernes n’est pas exclu quand celles-ci s’allient au savoir-faire traditionnel pour améliorer la qualité de nos couteaux.
Pour fabriquer un couteau de A à Z, l’artisan coutelier doit maîtriser de multiples savoir-faire. De la forge à la finition, les étapes sont nombreuses et requièrent une expertise propre. Les principales étapes de la production sont la forge, le montage, l’ajustage, le sciage, le façonnage, le ciselage et le polissage.
La forge est la mise en forme du métal. L’acier est chauffé puis forgé par l’artisan pour fabriquer une lame robuste et tranchante. Une fois forgée, la pièce d’acier est de nouveau montée en température puis trempée dans un bain d’huile qui lui confère dureté et élasticité. Nous proposons plusieurs types d’aciers forgés : inox, carbone ou damas.
L’artisan coutelier prépare et ajuste les pièces métalliques du couteau que sont la lame, le ressort, les mitres et les platines. Le ressort forgé est la partie centrale du manche sur laquelle repose la lame lorsque le couteau est fermé. Le couteau est ajusté en position ouverte et fermée afin de garantir son parfait fonctionnement mécanique et le bon maintien de la lame dont le fil ne doit pas être en contact avec le ressort lors de la fermeture.
La fiabilité du couteau dépend de la précision de cet ajustage.
Les matériaux utilisés pour la fabrication des manches sont débités à la main. Nous proposons plusieurs types de matières : bois, cornes et minéraux. Nous n’achetons que des matériaux nobles, de première qualité. D’un couteau à l’autre, l’aspect du manche n’est jamais identique car chaque pièce de matière est unique. Le manche est façonné manuellement.
Le ciselage, aussi appelé guillochage, est l’opération par laquelle le coutelier sculpte les parties métalliques du couteau. Le ressort, les platines peuvent être ciselés. Dans le cas du laguiole, on sculpte aussi la mouche qui orne le ressort.
Le polissage donne son éclat au couteau et révèle la matière du manche. Avant d’être expédié, le couteau est affuté, contrôlé et nettoyé.
>
>
Références >>



Celui qui tue des bœufs, des moutons, ou tout animal d’élevage et qui en vend au détail la chair crue.
Le boucher désosse les carcasses, découpe la viande en morceaux pour la présenter à la vente au détail. Il vide et nettoie également les volailles, les lapins et les gibiers.
provenance du nom :
(Fin du XIIe siècle) En ancien français 'bochier' « celui qui tue les animaux destinés à la consommation » ou 'boucier' « marchand de viande » ; attesté au treizième siècle au sens de « bourreau ». Dérivé de bouc avec le suffixe -ier, le 'boucher' étant à l'origine chargé d'abattre des boucs.
thématiques associées : métier de bouche
groupe d'activités : vente fabrication et transformation d’objet et produits
Références >>

Ouvrier dont le métier est de fabriquer des bouchons de carafe.
travaille : verre
Témoignage : ...On extrait l’argile en hiver. Le tuilier invitait des amis ou employait quelques journaliers pour extraire la « terre » (l’argile) par pallier. Le trou que l’on creusait n’était pas forcément très grand mais il pouvait être assez profond parfois.
On fabrique les tuiles en été, lorsqu’il n’y a pas de gel, et parce que la température plus clémente rend l’argile plus malléable. L’argile était quand même le plus souvent à fleur du sol, il y avait peu de terre à découvrir. On creusait le premier pallier sur environ 1 à 2 mètres, puis le deuxième et le troisième au maximum mais cela devenait très pénible. On laissait la « terre » sur le côté.
On passe la « terre » dans un broyeur technique vieille de 100 ans au moins, qui casse les cailloux puis dans le malaxeur qui brasse la pâte.
La pâte ressort au bout du malaxeur par une filière qui sert de matrice. Elle donne une forme à la tuile (courbe pour toiture ou tuile faîtière ) ou à la brique (3, 4, 6 ou 9 trous pour cloison ou mur).
On fabriquait également le macaron, une brique réfractaire pour les cheminées avec un moule ainsi qu’une brique réfractaire plus petite d’environ 2 cm d’épaisseur pour les fours à pain.La boule de terre mise dans le malaxeur ressort aplatie grâce à un contrepoids.Pour ne pas abîmer la tuile à la sortie, on utilisait un instrument en bois : le corbet. La tuile était déposée ainsi dans le chariot et mise à sécher dans les claies un certain temps. Le temps de séchage dépendait totalement du climat. Pour optimiser le temps de séchage, les hangars étaient très bas, afin que l’air passe.
Dans toute la commune du Tâtre, on peut voir des traces de trous. En général, ils se bouchaient naturellement avec des végétaux ou avec de l’eau. Ce n’est que très récemment qu’on s’est préoccupé de reboucher les trous formés par l’extraction de la terre.
>la commune du Tâtre,LES TUILERIES DU TÂTRE,
>la commune du Tâtre,LES TUILERIES DU TÂTRE,
Références >>

Celui qui fait, qui vend des bouchons de liège pour les bouteilles.
thématiques associées : ouvrier
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : bois et écorces
Modalités d'apprentissage : autre - manufacture
Références >>



Personne dont le métier est de fabriquer le pain et celui qui vend le pain.
provenance du nom :
Du picard 'boulenc' (« celui qui fabrique des pains ronds »), attesté vers 1100 en latin médiéval sous la forme 'bolengarius', 'bolengerius' ; devient, vers 1170 'bolengier' puis (1299) 'boulanger'.
Du francique 'bolla' « pain rond ».
thématiques associées : artisanat métier de bouche
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
milieu de travail : milieu urbain milieu rural
Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan,école (enseignement collectif)

Celui, celle qui achète des vieux livres pour les revendre - un libraire de livres anciens et d'occasion.
provenance du nom :
Dérivé de 'bouquin' - Du moyen néerlandais 'boeckin' (« petit livre »)
groupe d'activités : vente
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)
Références >>



Personne qui s’occupe, garde ou conduit des bœufs ou des vaches.
provenance du nom :
Du bas latin 'bo(v)arius' qui aurait eu le sens de « marchand de bœuf » ou de « gardien de bœuf » selon les régions.
thématiques associées : métier animalier
groupe d'activités : services
milieu de travail : milieu urbain milieu rural

fabriquant de bière
provenance du nom :
Du latin populaire *braciare, de braces (« blé blanc, malt »), apparenté à braise (« drêche »), brai. Le sens étymologique est proche de « (faire) fermenter »
thématiques associées : métier de bouche
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
Présence dans le lieu d'exercice : permanente
Modalités d'apprentissage : compagnonnage,transmission père en fils ou mère en fille - De la fin du quinzième siècle la durée de l’apprentissage fut fixée à trois ans ; ce temps révolu, en payant soixante sous à la communauté et en faisant son chef-d’œuvre en présence des jurés, on devenait maître.
A la fin du dix-huitième siècle L’apprentissage durait cinq années, et en outre, avant de passer maître, il fallait être trois ans compagnon et faire ensuite un chef-d’œuvre. Chaque maître ne pouvait avoir qu’un seul apprenti ; s’il en avait deux, l’un devait commencer sa première année quand l’autre entrait dans sa cinquième. Les fils de maître avaient le privilège d’ouvrir boutique en faisant simplement le chef-d’œuvre en présence des jurés.
Références >>



Celui qui fait ou qui vend de la brique.
Après l’avoir épurée, le briquetier malaxe l’argile pour la rendre homogène. Il l’étire en un boudin calibré, coupé à la longueur désirée. Le séchage s’effectue durant quatre jours à 90° C et la cuisson dans des fours tunnels durant trois jours à une température variant entre 570°C et 1050°C.
provenance du nom :
Emprunté du moyen néerlandais 'bricke', 'bricke' (« brique ») du verbe moyen néerlandais 'brecken' (« briser »). La brique étant caractéristique des Flandres.
Le terme est attesté en 1204, sous sa forme en ancien français 'brike' (« palet »), puis a dès la fin du XIIIe siècle, avec le sens qu’on lui connaît aujourd’hui. Il désigne également un morceau, une miette. le terme 'brike' est plutôt du nord, mais une forme 'briche' est attestée ailleurs.
thématiques associées : métier en rapport avec le bâtiment
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
Présence dans le lieu d'exercice : permanente
travaille : pierre, argile et matières rocheuses
organisation du travail : travail en groupe - La briqueterie doit être placée dans un site favorable : terrain plat, bien ventilé, à proximité de l'eau et d'un filon d'argile.
Les établissements étaient petits, toujours couplés avec une exploitation agricole. Il s'agissait pour le briquetier d'une activité complémentaire et saisonnière.
Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan - La transmission du savoir-faire s’effectue au sein des manufactures, par les artisans briquetiers eux-mêmes.
Témoignage : ... Le travail de l'argile commençait en automne. Dans la carrière, la terre était abattue et laissée sur place tout l'hiver. La pluie, la neige, le gel allaient la déliter… Au printemps, avant Pâques, elle était émiettée. L'opération se faisait à l'origine au sabre sur un plateau de bois. Ensuite un manège dallé fut utilisé. La terre était longuement piétinée par des animaux : vaches, chevaux… On se souvient encore, paraît-il, du fameux "cheval gris" de Saint-Médard. Un bandeau sur les yeux et un sac sous la queue pour éviter le crottin, il tournait longuement. La glaise était mouillée pour être bien pétrie, "patiassée" selon la belle expression locale. Il fallait enlever avec soin les cailloux "plus gros qu'un œuf de pigeon". C'était la règle. Mais parfois les pigeons étaient de belle taille ou alors l'ouvrier inattentif, précise malicieusement notre guide. La terre était ensuite mise dans une fosse à l'abri des intempéries pour le mûrissement, une sorte d'homogénéisation.
Ensuite la mise en forme dans un cadre souvent en bois se faisait à la main, à la truelle ou au battoir. Souvent c'était le travail d'adolescents et d'enfants. Ejectée avec les pouces (on voit encore les empreintes), la brique était portée au séchoir ou, à la demande, à la presse, toujours avec une main-d'œuvre juvénile. Un adulte maniait la lourde machine qui compactait et donnait l'empreinte.
Après un temps variable de séchage, le four était bourré des produits à cuire : plus de 30 000 pièces. Il est souvent carré et mesure 4 m sur 4 avec 6 à 7 m de hauteur. D'abord les briques, éléments stables, empilées avec soin en ménageant des tunnels pour mettre le combustible puis les tuiles rangées en faisceaux. Les ouvertures étaient bouchées. Le feu était allumé et alimenté par les "alandiers" ou bouches à feu. Il fallait d'énormes quantités de bois, bois de chauffage, non utilisable comme bois d'œuvre. Ce ne pouvait pas être du chêne. Il coûtait trop cher et son tanin tachait les briques.
Ensuite le temps des "fumées blanches" arrivait : deux ou trois jours de feu modéré pour finir le séchage. Quand la fumée devenait grise, il était temps de pousser le feu, progressivement, jusqu'à 900 degrés. Pendant combien de temps ? Tout était variable, évalué par le briquetier. Aucun pyromètre, pas d'appareil compliqué. L'expérience, le savoir-faire étaient très importants. Trois ou quatre craquements indiquaient que la cuisson avançait. Les produits se tassaient à cause du retrait des matériaux. Il y avait, bien sûr, de temps en temps des ratés, de la casse. Des briques trop cuites se vitrifiaient, des tuiles se soudaient entre elles. C'étaient les aléas du métier. Un peu comme le boulanger qui manque une fournée ! ...
>Paul Robert, Musée de la brique de Champdieu
>Paul Robert, Musée de la brique de Champdieu
Références >>
Wiktionnaire
Paul Robert, Joseph Barou Musée de la brique de Champdieu
Le patrimoine industriel de Poitou-Charentes: La fabrication des tuiles et des briques [Le patrimoine industriel de Poitou-Charentes, L'nventaire général du patrimoine culturel de Poitou-Charentes © Région Poitou-Charentes, 2007-2012 Les ressources naturelles > La terre > La fabrication des tuiles et des briques]
Paul Robert, Joseph Barou Musée de la brique de Champdieu
Le patrimoine industriel de Poitou-Charentes: La fabrication des tuiles et des briques [Le patrimoine industriel de Poitou-Charentes, L'nventaire général du patrimoine culturel de Poitou-Charentes © Région Poitou-Charentes, 2007-2012 Les ressources naturelles > La terre > La fabrication des tuiles et des briques]



commerçant spécialisé dans l’achat et la vente d’objets anciens
provenance du nom :
De 'brocanter' - Du bas-latin 'abrocamentum', « action d'acheter en gros et de revendre en détail ». Origine inconnue ou obscure,
groupe d'activités : vente
Références >>

Personne qui celui qui réalise des broderies, i.e. qui garnit au moyen d’une aiguille de dessins en relief d’or, d’argent, de soie, de laine ou plus souvent de coton.
provenance du nom :
De 'broder' - De l’ancien français 'brosder', 'broisder', de l’ancien bas francique 'brosdôn', composition de 'borst' « soie (de sanglier, cochon) » et de 'brordôn' « broder » (cf. allemand Borste « soie de sanglier » ; vieux saxon 'brordôn' « broder, décorer », 'brord' « aiguille »)
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
milieu de travail : milieu urbain milieu rural
travaille : textile, fil et laine
Références >>



Celui, celle qui fabrique ou vend des brosses. La brosserie traditionnelle concerne la fabrication des brosses à cheveux, brosses de toilettes (brosse à dents, brosse à ongles, brosse de maquillage etc.), brosses à habits, pinceaux, brosses de ménage, balais et plumeaux. Le brossier utilise plexiglas, rhodoïd, bois précieux et autres matériaux naturels. Une fois sciée, l’ébauche est façonnée à la main. Après le polissage, il procède au perçage et contreperçage des logements où sont fixées les touffes de soies animales ou loquets.
provenance du nom :
(XIIe siècle) De l’ancien français 'broce' (« broussaille, menu bois, broutille ») dont le sens s'est conservé dans le verbe 'brosser', en langage de chasse : « courir à travers des bois épais ». L'espagnol a 'broza' (« déchet d'arbre »). On peut aussi le rapprocher de l’occitan 'brusc' et de 'bruyère'.
Le mot provient du vieil allemand 'burst, brusta' (par métathèse du R) signifiant « quelque chose de hérissé » d'où le sens de « touffe de poils, de cheveux, soies » dont la forme primitive pointe encore dans à rebours (« à contre-poil ») transposé en 'rebrousser'; 'Bürste' en allemand moderne.
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
travaille : bois et écorces cuir, fourrures, cheveux fibres, lianes et brins végétaux
Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan

fabricant de cannes
provenance du nom :
Du latin canna (« roseau »).
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : bois et écorces
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)
Références >>

Celui, celle qui carde, c'est-à-dire qui démêle des fibres textiles et les peigne à l'aide d'une carde.
provenance du nom :
Du latin 'carduus', « chardon », et du bas-latin 'cardo', « instrument à carder », employé à carder la laine.
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : services fabrication et transformation d’objet et produits
milieu de travail : métier ambulant
travaille : fibres, lianes et brins végétaux
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé) - Le cardeur passait le plus souvent à partir du printemps pour découdre les matelas, carder les fibres textiles et recoudre les matelas. L'artisan se déplaçait avec sa carde au domicile du client et travaillait le plus souvent à l'extérieur à cause de la poussière dégagée.
Références >>



Celui, celle qui exploite une carrière ou un ouvrier travaillant dans une carrière pour l’extraction de matériaux de construction. Le carrier est le premier artisan à travailler la pierre. Sans lui, tailleurs de pierre, sculpteurs, paveurs… n'auraient pas de matière première à transformer.
provenance du nom :
Dérivé de 'carrière' - Du vieux français 'quarrière', du latin populaire 'quadraria', « lieu où l’on taille les pierres », de 'quadrus', « carré ».
thématiques associées : métier en rapport avec le bâtiment
groupe d'activités : exploitation et extraction des ressources naturelles
travaille : pierre, argile et matières rocheuses
organisation du travail : travail en groupe



fabricant et/ou vendeur de cartes à jouer et tarots
provenance du nom :
Du latin 'charta' (« papier, écrit, livre »), lui-même du grec ancien χάρτης 'kartès' (« feuille de papyrus ou de papier »)
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan,compagnonnage - Comme dans la plupart des métiers, il était défendu d’avoir plus d’un apprenti, et les maîtres ne devaient pas se prêter leurs compagnons. Tous les maîtres cartiers devaient avoir une marque différente ; du reste le valet de trèfle portait toujours le nom du fabricant. Enfin, pour faire observer les règlements la communauté élisait tous les ans deux jurés. On voit que l’organisation n’était pas des plus compliquées : c’est ce que l’on constate toujours quand on a affaire à une corporation peu ancienne.
Références >>

Producteur de châtaignes.
provenance du nom :
Du latin 'castanea' (« châtaigne ») et 'culture'.
thématiques associées : métier agricole
groupe d'activités : production agricole
milieu de travail : milieu naturel
Présence dans le lieu d'exercice : permanente
organisation du travail : travail en groupe - Travaux d'hivers - travail sur les arbres, élagage des arbres, sévère pour les arbres fortement atteint ou plus léger par la coupe des branches mortes pour les autres.
Début du greffage aux alentour du 15 mars en fonction de la montée de sève. Suite du greffage jusqu'à la mi-avril, entretien des greffes toutes les semaines, enlèvement des liens qui maintiennent les greffons des greffes en couronne, pour les greffes de mars et qui ont bien démarrées, élimination des gourmands, badigeonnage des points de greffe.
Mais et juin - entretien des greffes.
Pose des ruches à la mi- juin.
Juillet-aoûy - travaux d'entretien sur les greffes, tailles.
Septembre - Préparation de la récolte par la coupe des mauvaises herbes et des fougères, la coupe doit être très rase pour éviter que les châtaignes restent sur un gazon d'herbe et donc dans l'humidité les jours de rosée. Chute des premières châtaignes vers le 25 septembre, elles sont rapidement dégustées par les sangliers qui souvent mangent les bogues avant même leur tombée au sol.
Références >>

Faiseur ou marchand de ceintures, ceinturons ou baudriers.
provenance du nom :
Du latin 'cingere' (« ceindre, entourer »).
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
travaille : cuir, fourrures, cheveux
Références >>

Ouvrier qui fait de grosses chaînes, par opposition au 'chaînetier', qui fait de petites chaînes.
provenance du nom :
(1795) Du français 'chaîne' - Du latin 'catena' qui donne l'ancien français 'caiene', 'chaiene', 'chaene'.
thématiques associées : ouvrier
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : métal
Références >>

associé au métier de gantier. Le chamoiseur travaillait le cuir (en général à l’aide d’huile de poisson) afin de le rendre aussi souple que la peau de chamois.
provenance du nom :
En ancien français 'camois', d’un pré-roman alpin 'kamōke', attesté chez Polemius Silvius sous la forme 'camox', apparenté à 'camoscio' en italien, 'camoç' en occitan.
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : cuir, fourrures, cheveux
Références >>

Fabricant ou marchand de chandelles. Le chandelier, travaille avec du suif. Celui-ci est obtenu à partir de graisses animales fondues et clarifiées ou épurées. Le chandelier se cantonne à la transformation du suif en chandelle.
Le suif le meilleur pour faire les chandelles, est le suif de mouton; cependant comme il est très solide on peut y mélanger partie égale de suif de bœuf, sans altérer la bonté des chandelles.
Le chandelier ne fabrique pas seulement les chandelles, mais souvent les vend ou les fait vendre
provenance du nom :
De 'chandelle' avec le suffixe -ier.
Du latin 'candela' (« chandelle ») - de 'candeo' (« briller »)
thématiques associées : artisanat ouvrier
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
travaille : suif
Références >>

fabricant ou commerçant en chapeaux
Le chapelier fabricant réalise des chapeaux en série : sur des formes en bois (travail au plateau), à la presse sur des formes en aluminium (travail à la pédale), en assemblant des tresses sur des machines chaînette, en assemblant des pièces de tissu sur des piqueuses plates.
Chapelier et modiste, bien que réalisant le même produit, ont une conception différente du chapeau et font appel pour sa fabrication à des savoir-faire qui leur sont propres. Le chapelier travaille surtout le feutre, la paille et le tissu. Il produit en grande série ou en série limitée des chapeaux classiques d'homme et de femme. Le travail du modiste relève de la création et du domaine artistique. Le chapeau est conçu comme un objet unique principalement destiné aux femmes. Un professionnel qui est à la fois chapelier et modiste est parfois appelé " fantaisien ". Le chapelier réalise des chapeaux en une seule pièce : bords et calotte (partie supérieure du chapeau) forment un tout. Il prend les mesures du volume de la tête du client.
Chapelier et modiste, bien que réalisant le même produit, ont une conception différente du chapeau et font appel pour sa fabrication à des savoir-faire qui leur sont propres. Le chapelier travaille surtout le feutre, la paille et le tissu. Il produit en grande série ou en série limitée des chapeaux classiques d'homme et de femme. Le travail du modiste relève de la création et du domaine artistique. Le chapeau est conçu comme un objet unique principalement destiné aux femmes. Un professionnel qui est à la fois chapelier et modiste est parfois appelé " fantaisien ". Le chapelier réalise des chapeaux en une seule pièce : bords et calotte (partie supérieure du chapeau) forment un tout. Il prend les mesures du volume de la tête du client.
provenance du nom :
Du latin 'capellus', dérivé de 'cappa' (capuchon)
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
travaille : fibres, lianes et brins végétaux textile, fil et laine

Personne qui prépare et qui vend alimentaires à base de viande et d'abats, crues ou cuites.
La charcuterie concerne outre la viande de porc, diverses viandes, notamment de gibier (terrines et saucisson de sanglier, par exemple), de bœuf (viande des Grisons), de volaille (rillettes d'oie, de canard, jambon de dinde, terrine de lapin).
provenance du nom :
(1464) chaircuitier, de 'chair' et 'cuit'.
thématiques associées : métier de bouche artisanat ouvrier
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
Références >>

Personne qui conduit une charrette.
provenance du nom :
De ‘charrette’, le diminutif de ‘char’ - du gaulois transalpin ‘carros’ (« char(rette) à quatre roues »), d’où le latin ‘carrus’ (« char »).
thématiques associées : métier animalier
groupe d'activités : services
milieu de travail : milieu urbain milieu rural milieu naturel métier ambulant
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé),travail en groupe

Un métier désignant à l'origine celui qui réalise des chaudrons, puis par extension les personnes qui réalisent des enveloppes de corps creux, en métal, et/ou en matière plastique, de toutes natures et toutes destinations. Il/elle façonne les pièces de métal pour leur donner forme... Il/elle travaille à la main, avec une précision d’artisan.
thématiques associées : artisanat ouvrier
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : métal
Références >>

Gardien ou éleveur de chèvres
provenance du nom :
De chèvre et du suffixe -ier.
thématiques associées : métier animalier
groupe d'activités : production agricole
milieu de travail : milieu urbain milieu rural milieu naturel métier ambulant
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)
Références >>



Récupérateur de vieux objets : métaux, verre, peaux, os, etc. Celui qui vit de la revente des objets qu'il ramasse. Un chiffonnier est une personne dont le métier consiste à passer dans les villes et villages pour racheter des choses usagées et les revendre à des entreprises de transformation.
provenance du nom :
De 'chiffon', avec le suffixe -ier.
Mot composé de 'chiffe' et -on. De l’ancien français 'chipe' (« chiffon »), lui-même de l’arabe شف, 'chif' (« étoffe légère et transparente »)
groupe d'activités : vente ramassage
milieu de travail : milieu urbain milieu rural métier ambulant
travaille : cuir, fourrures, cheveux verre métal textile, fil et laine papier
Références >>



L'artisan qui fabrique des bougies et des cierges. IL travaille un mélange de cire animale (cire d’abeille), minérale (paraffine) et végétale. La cire fondue est teintée dans la masse. La forme droite ou conique de la bougie dépend de la technique employée pour déposer la cire sur la mèche, « à la louche » ou « à la plongée ».
La cire ne sert pas uniquement à fabriquer des cierges ou des bougies. Certains maîtres ciriers sont plus spécialement chargés de réaliser les effigies mortuaires des rois. D'autres ciriers se spécialisent dans la confection de figures de cire, des reproductions anatomiques en cire, ...
provenance du nom :
De 'cierge' - Du latin 'cereus' (« en cire, de cire »).
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : cire
Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan,transmission père en fils ou mère en fille
Témoignage : ... L'organisation du travail était souvent par journée. A savoir, une journée entière de coulage puisque lorsque la température de la bassine était atteinte, il était plus judicieux de la maintenir pour plusieurs heures. A une époque le coulage se faisait à semaine entière (les parents de mon beau-père avaient 3 ouvriers). Il faut préciser que les bougies des églises étaient neuves à chaque office...!!! elles étaient donc reprises, fondues, filtrées et re-coulées.
Les bougies étaient donc mises en stock en attendant une commande. Ensuite venaient les étapes de roulage, perçage et étêtage. Pour que je puisse faire mes photos, mon beau-père m'a montré toutes ces tâches en une journée. (...)
La cire, une fois ramollie, était travaillée pour faire ressortir des décors en relief, qui étaient ensuite dorés à l'or fin et quelquefois simplement peints. Chacune a un motif différent. Il suffit de pincer la cire molle pour faire ressortir le motif. Vous le travaillez en cercle pour obtenir une fleur ou en pourtour de la bougie pour faire une frise. ...
>FIN DU REPORTAGE SUR LE METIER DE CIRIER, 11 mars 2010
>FIN DU REPORTAGE SUR LE METIER DE CIRIER, 11 mars 2010
Références >>
Wiktionnaire
Wikipédia - Cirier (métier)
Cirier Métier du secteur : Arts et traditions populaires [INMA - Institut National des Métiers d'Art]
Lucile Ageron Il est l'un des derniers fabricants de cierges en France. [Les Nouvelles - l’Écho, Vion]
XX LE CIRIER ET LE CHANDELIER [D'après un article de Florence Fourré-Guibert]
Wikipédia - Cirier (métier)
Cirier Métier du secteur : Arts et traditions populaires [INMA - Institut National des Métiers d'Art]
Lucile Ageron Il est l'un des derniers fabricants de cierges en France. [Les Nouvelles - l’Écho, Vion]
XX LE CIRIER ET LE CHANDELIER [D'après un article de Florence Fourré-Guibert]

Ouvrier travaillant à la confection des cigares.
provenance du nom :
De 'cigare' - de l’espagnol 'cigarro' (« cigarette »), dérivé de 'cigarra' (« cigale ») par analogie de forme et de taille des premières cigarettes avec l’insecte.
Références >>

Personne qui fabrique ou qui vend des clous pour les souliers et la ferrure des chevaux, mulets, ânes et bœufs. A l'origine, les clous étaient fabriqués par des forgerons.
fabriquaient et vendaient des clous en qualité de membres de la communauté des cloutiers-lormiers-étameurs-ferronniers.
fabriquaient et vendaient des clous en qualité de membres de la communauté des cloutiers-lormiers-étameurs-ferronniers.
provenance du nom :
De 'clou' -Du latin 'clavus'.
thématiques associées : artisanat ouvrier
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : métal
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé) - Dans certaines régions, cette fabrication devint la spécialité des paysans qui ne pouvaient travailler leur terre durant les mois d'hiver. Ils disposaient dans le sous-sol du charbon de pierre qui leur permettait d'alimenter à peu de frais leur forge.|La fabrication des clous étaient réalisée avec une tringle de fer ( verge) fabriquée dans desn'fenderies'.
Un bon cloutier ne produisait guère
plus de cent clous à l’heure pour les petites tailles et cinq cent clous par jour pour les grandes tailles.
Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan - L’apprentissage durait six ou huit ans. Passé ce temps, l’apprenti était reçu ouvrier, puis maître.
Références >>

Celui qui coupe les cheveux et les coiffe. Il peut travailler dans un salon de coiffure, à son domicile ou chez son client.
provenance du nom :
De l’ancien français ‘coife’, du latin ‘cofia’.
thématiques associées : artisanat ouvrier
groupe d'activités : services
milieu de travail : milieu urbain milieu rural
travaille : cuir, fourrures, cheveux
Références >>



Un artisan spécialisé dans la confiserie, fabrication de produits comestibles dont le sucre est un composant essentiel — à l'exclusion des confitures, gelées et marmelades — et qui en fait éventuellement le commerce. Relèvent donc de son art toutes sortes de friandises sucrées et les bonbons.
provenance du nom :
(1226) Du latin conficere (cum + facere), « préparer ».
thématiques associées : métier de bouche artisanat ouvrier
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
Références >>

un artisan qui fabrique des confitures
provenance du nom :
Du bas latin 'confictura' dérivé de 'confingere' (« façonner ») composé du préfixe con- (« ensemble ») et de 'fingere' (« faire »).
thématiques associées : métier de bouche artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
Références >>

Personne qui copie, et, notamment autrefois, dont le métier était de copier des textes manuscrits ou de la musique.
un professionnel chargé de la reproduction de documents écrits ou d’œuvres d'arts. Ce métier est né de la nécessité de produire des copies de documents administratifs et de textes destinés à l'enseignement et à la propagation du savoir, bien avant l'invention de l'imprimerie, puis de la photographie et d'autres moyens de reproduction.
un professionnel chargé de la reproduction de documents écrits ou d’œuvres d'arts. Ce métier est né de la nécessité de produire des copies de documents administratifs et de textes destinés à l'enseignement et à la propagation du savoir, bien avant l'invention de l'imprimerie, puis de la photographie et d'autres moyens de reproduction.
provenance du nom :
Du latin 'copia' (« abondance ») dont est issu copieux ; copia est composé de 'co-' (préfixe intensif) et 'op's (« moyens, ressources, pouvoir », « richesse »).
groupe d'activités : communication
travaille : papier
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)
Références >>

Des marchands ambulants qui récoltaient les produits frais tels que les œufs, le beurre, puis par la suite des volailles ou encore des légumes. Ils passaient dans les fermes acheter ces produits qu'ils revendaient ensuite au marché.
groupe d'activités : vente
milieu de travail : milieu urbain milieu rural métier ambulant

Celui qui fabrique ou qui vend des cordes (au sens propre, une corde est un corps long, flexible, résistant, rond, composé de fils tordus et/ou tressés ensemble dont on se sert comme outil pour lier, attacher, haler, hisser, etc.).
provenance du nom :
(1240) Dérivé de 'corde'- Du latin 'corda', variante de 'chorda', signifiant proprement « boyau », puis « corde » en général.
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : fibres, lianes et brins végétaux
Modalités d'apprentissage : compagnonnage,transmission père en fils ou mère en fille
Références >>

Personne qui fabrique, répare et vend des chaussures.
provenance du nom :
(1255) 'Cordoanier', de l’ancien français 'cordoan' (« cuir de Cordoue »), en référence à Cordoue, ville espagnole dont le cuir était jadis très réputé.
savetier - du moyen français ‘savate’, lui même de l’ancien français ‘chavate’. « vieux soulier très usé »
savetier - du moyen français ‘savate’, lui même de l’ancien français ‘chavate’. « vieux soulier très usé »
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : réparation vente fabrication et transformation d’objet et produits
milieu de travail : milieu urbain milieu rural
Présence dans le lieu d'exercice : permanente
travaille : cuir, fourrures, cheveux
Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan,compagnonnage - Pour être reçu à la maîtrise, il fallait avoir été apprenti chez les maîtres de la ville et avoir fait publiquement le chef-d’oeuvre, à l’exception des fils de maître qui n’étaient pas tenus à des obligations aussi strictes.
Références >>

Un couturier spécialisé dans la fabrique des corsets.
thématiques associées : métier de l’habillement
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
travaille : textile, fil et laine
Références >>



Un artisan ambulant qui passait dans les villages pour couper les cheveux des femmes afin d'en faire des perruques.
Les cheveux se vendent au gramme et varient, de valeur suivant leur finesse, leur longueur et leur nuance: dans l'ordre de rareté, se placent d'abord les châtains et les blonds, puis les bruns, les rouges, les gris et les blancs. Ces derniers sont presque introuvables et atteignent, des prix fantastiques.
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : services
milieu de travail : métier ambulant
travaille : cuir, fourrures, cheveux
Références >>

Les coupeurs de glace sont des hommes qui coupaient la glace sur les lacs gelés, sur des cours d'eau gelés durant l'hiver, et sur les glaciers ( les ouvriers faisaient reculer le glacier d'un mètre par jour, lui, pendant la nuit, regagnait le terrain perdu).
thématiques associées : ouvrier
groupe d'activités : exploitation et extraction des ressources naturelles
milieu de travail : milieu naturel
Présence dans le lieu d'exercice : intermittente
organisation du travail : travail en groupe - Ce métier, aujourd'hui disparu, était physiquement difficile. Armés de scies à glace, ces hommes devaient s'aventurer sur les lacs, les rivières et le fleuve pour y tailler des blocs de glace, les hisser sur la surface gelée avec l'aide de chevaux ou de machines, les embarquer sur la chaine, les placer dans l'entrepôt et les recouvrir de bran de scie.
La glace devait mesurer au moins 50 centimètres d'épaisseur pour être récoltée car il fallait qu'elle puisse supporter le poids des ouvriers et des chevaux et pouvoir être découpée en blocs.
Il existait plusieurs types de glace ; la plus recherchée était dure et transparente et était destinée à la consommation humaine tandis que la glace poreuse et de couleur blanche avait moins de valeur et était vendu à l'industrie.
La découpe de la glace comprenait plusieurs étapes et était généralement réalisée la nuit quand la glace était la plus épaisse La neige à la surface était d'abord retirée avec des racloirs, l'épaisseur de la glace était évaluée et la surface était entaillée pour délimiter les futurs blocs.
Références >>



Personne dont le métier est de fabriquer, de réparer, ou de vendre des couteaux et autres instruments tranchants : couteaux de table, couteaux fermants, couteaux de cuisine et de boucherie, rasoirs, instruments de chirurgie, ciseaux, etc.
L'artisan coutelier forge un bloc, généralement d’acier. Il affine la matière par traitement thermique en deux temps, la trempe et le revenu, afin d’ajuster dureté et flexibilité. Par l’émouture, il assure le tranchant de la lame.
provenance du nom :
(1160) De 'couteau' - Du latin 'cultellus', diminutif de 'culter' (« couteau », « fer de charrue») qui a également donné « coutre » en français.
'Couteau' est étymologiquement lié aux 'cultures' (qui sont travaillées avec le 'culter', le « soc » de la charrue) et au 'culte' (ce qui est « coupé », que ce soit avec le couteau (sacrifice), soit avec le soc : dans la Rome antique, nombre de cérémonies religieuses, qu’elles soient liées à la fertilité ou à la démarcation sacré / profane, comprennent l’usage de la charrue.
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : métal bois et écorces cornes,os, ivoire
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)
Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan
Témoignage : Notre processus de fabrication fait la part belle à l’intervention humaine, au savoir-faire manuel, à l’œil expert de l’artisan. Le recours aux machines est limité : nous utilisons des outillages traditionnels en matière de forge, de gravure ou de polissage. Pour autant, le recours aux technologies modernes n’est pas exclu quand celles-ci s’allient au savoir-faire traditionnel pour améliorer la qualité de nos couteaux.
Pour fabriquer un couteau de A à Z, l’artisan coutelier doit maîtriser de multiples savoir-faire. De la forge à la finition, les étapes sont nombreuses et requièrent une expertise propre. Les principales étapes de la production sont la forge, le montage, l’ajustage, le sciage, le façonnage, le ciselage et le polissage.
La forge est la mise en forme du métal. L’acier est chauffé puis forgé par l’artisan pour fabriquer une lame robuste et tranchante. Une fois forgée, la pièce d’acier est de nouveau montée en température puis trempée dans un bain d’huile qui lui confère dureté et élasticité. Nous proposons plusieurs types d’aciers forgés : inox, carbone ou damas.
L’artisan coutelier prépare et ajuste les pièces métalliques du couteau que sont la lame, le ressort, les mitres et les platines. Le ressort forgé est la partie centrale du manche sur laquelle repose la lame lorsque le couteau est fermé. Le couteau est ajusté en position ouverte et fermée afin de garantir son parfait fonctionnement mécanique et le bon maintien de la lame dont le fil ne doit pas être en contact avec le ressort lors de la fermeture.
La fiabilité du couteau dépend de la précision de cet ajustage.
Les matériaux utilisés pour la fabrication des manches sont débités à la main. Nous proposons plusieurs types de matières : bois, cornes et minéraux. Nous n’achetons que des matériaux nobles, de première qualité. D’un couteau à l’autre, l’aspect du manche n’est jamais identique car chaque pièce de matière est unique. Le manche est façonné manuellement.
Le ciselage, aussi appelé guillochage, est l’opération par laquelle le coutelier sculpte les parties métalliques du couteau. Le ressort, les platines peuvent être ciselés. Dans le cas du laguiole, on sculpte aussi la mouche qui orne le ressort.
Le polissage donne son éclat au couteau et révèle la matière du manche. Avant d’être expédié, le couteau est affuté, contrôlé et nettoyé.
>
>
Références >>

Fabricant de matelas, celui, celle qui tisse du coutil (i.e toile faite de fil de chanvre ou de lin, mélangée quelquefois de coton, lissée et serrée).
provenance du nom :
Du latin 'culcita' (« matelas »).
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : textile, fil et laine
Références >>



Personne qui fabrique ou retouche des vêtements, celui qui taille des habits, qui fait des vêtements.
Le tailleur-couturier réalise des vêtements sur mesure d'après les attentes d'un client. Il lui propose un modèle existant, en adapte un ou en crée un nouveau. Il le conseille sur la coupe du vêtement (droit, cintré, à pinces) en fonction de sa morphologie, et l'aide à choisir le tissu.`
Tailleur, qui se consacre aux vêtements masculins, du couturier "flou", spécialiste du vêtement féminin.
provenance du nom :
En ancien français 'talier', du latin médiéval 'taliare' (sens identique)
Du latin 'consutura' composé de con- et 'sutura' ou dérivé de 'consuere', 'consutum' (« coudre »).
Du latin 'consutura' composé de con- et 'sutura' ou dérivé de 'consuere', 'consutum' (« coudre »).
thématiques associées : métier de l’habillement artisanat
groupe d'activités : réparation vente services fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : textile, fil et laine
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé),travail en groupe



Marchand d'huiles et de graisses, débitants de graisses, d'huiles, etc.
Les épiciers, les droguistes des provinces prenaient parfois ce titre. La grande ordonnance du 30 janvier 1351 mentionne les 'marchans de gresses'.
groupe d'activités : vente
Références >>
P. Reymond DICTIONNAIRE des VIEUX METIERS. 1 200 METIERS DISPARUS OU OUBLIÉS
Jean-Louis MOREL Métiers d'Autrefois Illustrés sur le Net [site Web]
Alfred Franklin Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis le treizième siècle [avec une préface de M. E. Levasseur, H. Welter (Paris), 1906]
Jean-Louis MOREL Métiers d'Autrefois Illustrés sur le Net [site Web]
Alfred Franklin Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis le treizième siècle [avec une préface de M. E. Levasseur, H. Welter (Paris), 1906]



Personne qui tient une crémerie, un commerce de produits laitiers (crème, mais aussi lait, beurre, fromage, etc.).
provenance du nom :
De l’ancien français 'cresme', du bas latin 'crama', mot gaulois (VIe siècle) croisé avec le latin chrétien 'chrisma', « chrême ».
thématiques associées : métier de bouche
groupe d'activités : vente
Références >>

Celui qui s'occupe d'une vente à la criée.
La vente à la criée est une opération par laquelle une personne appelée vendeur interpelle de vive voix des acheteurs potentiels dans le but de leur vendre un bien.
provenance du nom :
Du latin 'quiritare' (« crier, hurler ») réduit en 'critare' en latin populaire.
groupe d'activités : vente
Références >>

celui qui cueille, ramasse des fruits
groupe d'activités : production agricole
organisation du travail : travail en groupe - travail saisonnier| Les opérations à réaliser sont le plus souvent manuelles. Elles sont étroitement liées à certains cycles saisonniers et limitées dans le temps.
Modalités d'apprentissage : apprentissage par le travail,courte instruction



Fabricant de dés à jouer.
Le corps de métiers qui prenait le titre de Deycier, faisait en même temps les échecs et les tables du jeu de dames et de marelles.
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : bois et écorces pierre, argile et matières rocheuses cornes,os, ivoire
Références >>
Geneawiki - Deillier [Lexique des métiers anciens - lettre D]
Sébastien Bottin Mélanges sur les Langues, Dialectes et Patois, renfermant, entre autres, une collection de versions de la Parabole de l'enfant prodigue en cent idiomes ou patois différens, presque tous de France : précédés d'un essai d'un travail sur la géographie [Edited by S. Bottin, Published 1831, Paris, p.554]
Léon de Laborde Glossaire français du Moyen âge : à l'usage de l'archéologue et de l'amateur des arts. [Slatkin, Genève 1872 ]
Sébastien Bottin Mélanges sur les Langues, Dialectes et Patois, renfermant, entre autres, une collection de versions de la Parabole de l'enfant prodigue en cent idiomes ou patois différens, presque tous de France : précédés d'un essai d'un travail sur la géographie [Edited by S. Bottin, Published 1831, Paris, p.554]
Léon de Laborde Glossaire français du Moyen âge : à l'usage de l'archéologue et de l'amateur des arts. [Slatkin, Genève 1872 ]

Artisan d'art, le dinandier fabrique des objets utilitaires et décoratifs par martelage à partir d'une feuille de cuivre, d'étain ou de fer-blanc.
Le métier de dinandier est la forme noble, voire artistique, du métier de chaudronnier.
provenance du nom :
Ce nom est issu de Dinant en Belgique, où la tradition du travail du cuivre remonte au XIIe siècle
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : métal
Modalités d'apprentissage : compagnonnage

Celui qui fabrique et vend des produits obtenus par distillation des plantes aromatiques et médicinales.
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
milieu de travail : milieu urbain



Une personne habilitée à produire eaux-de-vie. Le distillateur ambulant est la personne qui passe de village en village pour transformer la matière première en un breuvage fort apprécié.
provenance du nom :
(XIIIe siècle) Du latin 'destillare' (« tomber goutte à goutte »), de 'stilla', « goutte ».
thématiques associées : métier de bouche
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
milieu de travail : métier ambulant
Présence dans le lieu d'exercice : intermittente
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)
Témoignage : ... Je distille depuis 1930. Avant, ce droit de bouillir, on en héritait. Moi, je l'ai reçu de ma belle-mère. C'est moi qui allumais l'alambic de l'ancien distillateur, qui venait d'Airaines. Quand il arrivait, tout était chaud, il pouvait commencer. Maintenant, on fait de l'eau-de-vie avec le cidre, mais avant c'étaient les pommes pressées qu'on distillait. Cela s'appelait du marc de pomme. On en tirait nettement moins. ...
>(Albéric MARCHAND, 99 ans, doyen des bouilleurs de cru du distillateur ambulant : Jacques Bamière (Somme 80)) La petite goutte des bouilleurs de cru... dans : PAYS DU NORD N°34 - Article de Isabelle BOIDANGHEIN-GRYMONPREZ - Avril 2000
>(Albéric MARCHAND, 99 ans, doyen des bouilleurs de cru du distillateur ambulant : Jacques Bamière (Somme 80)) La petite goutte des bouilleurs de cru... dans : PAYS DU NORD N°34 - Article de Isabelle BOIDANGHEIN-GRYMONPREZ - Avril 2000



celui qui fabrique des meubles (le mobilier) à partir d’ébène ou de bois
provenance du nom :
Emprunté au latin 'ebenus' (« ébénier ; bois de l’ébénier »), lui-même emprunté au grec ancien ἔβενος, 'ébenos', d’origine égyptienne.
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : bois et écorces
Références >>

Celui qui ôte la boue, qui est chargé du ramassage des ordures ménagères.
provenance du nom :
Du verbe 'ébouer' (« enlever la boue »)
thématiques associées : ouvrier
groupe d'activités : services ramassage
milieu de travail : milieu urbain milieu rural
Modalités d'apprentissage : courte instruction - Aucune qualification spécifique n'est nécessaire. Il est toutefois préférable d'être en bonne forme physique.
Références >>

Personne dont le travail consiste à ouvrir et à vendre des huîtres, des coquillages. L’écailler prépare les plateaux de fruits de mer.
provenance du nom :
De 'écaille' - l’ancien nom donné à l’huître.
thématiques associées : métier de bouche
groupe d'activités : vente
Références >>

Celui qui élève des animaux domestiques (porc, vache, chèvre, cheval, poule, brebis, ...).
Un éleveur ou une éleveuse s'occupe des animaux à des fins commerciales. Il les nourrit, les soigne et contrôle leur reproduction.
provenance du nom :
(1611) Dérivé de élever avec le suffixe -eur. Au XIIe siècle, signifie « celui qui élève moralement ».
thématiques associées : métier animalier
groupe d'activités : production agricole
milieu de travail : milieu rural milieu naturel
Témoignage : L'essentiel de mon travail, de décembre à mars, est de donner à manger aux animaux dans les bâtiments et de faire la litière (répandre la paille). C'est aussi la période de mise bas (naissances). Je soigne les animaux malades, comme les petits veaux qui peuvent souffrir de diarrhées ou d'autres bobos récurrents. Sinon, je fais appel à un réseau de vétérinaires du secteur. À partir du printemps, je m'occupe de la remise en état des clôtures, je fais la tournée de toutes les pâtures pour m'assurer que tous mes animaux sont présents. En été, je m'attaque à la récolte du foin et des céréales qui vont nourrir les animaux en hiver. J'épands le fumier sur les prairies en automne, en guise d'engrais. Avec mon père, on s'est aussi lancés dans la vente de viandes et de terrines. On vend par téléphone et on livre à Paris, Lyon et Marseille. Le contact avec les clients permet de mieux valoriser nos animaux et notre travail dans la ferme. Il est nécessaire de s'ouvrir à d'autres productions et de rester attentif aux évolutions. L'installation n'est pas une fin en soi : on peut ensuite suivre une formation pour apprendre de nouvelles techniques et découvrir de nouveaux marchés.
>David, éleveurde vaches charolaises, dans sa ferme familiale à Génelard (71)
>David, éleveurde vaches charolaises, dans sa ferme familiale à Génelard (71)

Un épicier est quelqu'un qui travaille dans une épicerie où il vend des aliments. L'épicier est un travailleur indépendant, archétype du commerce de détail de proximité.
provenance du nom :
De 'épice' - Du latin 'species' (« espèce », mais aussi « denrée, drogue », puis « aromates, épices »). Semblablement, l’apothicaire nommait ses drogues 'species', non pas des drogues en général, mais des drogues particulières et spéciales, l’italien nomme l’apothicaire 'speziale'.
Certains tirent 'épice' et 'épicier' de l’arabe أبزار, 'abzâr' ou أبازير 'abâzir' de même sens, et l’apparentent à bazar ou à l’espagnol 'abacería' (« épicerie »); contre cette hypothèse, le fait que l’espagnol 'abacería' provient d’un autre étymon que أبزار et que ce même espagnol a 'especia' (« épice »).
groupe d'activités : vente
milieu de travail : milieu urbain milieu rural
Présence dans le lieu d'exercice : permanente
Modalités d'apprentissage : transmission père en fils ou mère en fille
Références >>



Celui, celle qui fabrique ou vend des épingles.
L’épingle se composa, dès les temps les plus anciens, d’une tige de laiton appointée et terminée à l’opposé de la pointe par une tête tournée et fixée. Au moyen âge, les dames en usèrent et en abusèrent : les légers ornements de coiffures nécessitaient l’emploi de milliers d’épingles.
provenance du nom :
De 'épingle' en ancien français 'espingle' ; selon Diez, du latin 'spinula' (« petite épine ») (et non pas de son diminutif 'spinicula') avec un 'g' intercalaire. Les dialectes français ont : 'éplingue' en champenois, 'épieul'e en picard.
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : vente fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : métal
Références >>



Fabricant et/ou marchand d'écuelles (écuelle - récipient creux en métal, en bois ou en argile, qui sert à mettre du bouillon, du potage, de la nourriture,) auges (i.e. un récipient, qui sert à donner à boire et à manger aux animaux domestiques) et de seaux.
provenance du nom :
Du latin scutella (« écuelle »);
Forme collatérale de 'scutum'(« bouclier » [originellement oval et creux]).
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
milieu de travail : milieu urbain milieu rural
travaille : bois et écorces métal
Références >>
Wiktionnaire
D. Chatry Les Métiers de nos Ancêtres [consultation 08/11/2015]
P. Reymond DICTIONNAIRE des VIEUX METIERS. 1 200 METIERS DISPARUS OU OUBLIÉS
Geneawiki [l'encyclopédie de la généalogie, écrit coopérativement par ses lecteurs.]
XX Les vieux «Mestiers» du bois et de la forêt. [PDF [en ligne]]
Sébastien Bottin Mélanges sur les Langues, Dialectes et Patois, renfermant, entre autres, une collection de versions de la Parabole de l'enfant prodigue en cent idiomes ou patois différens, presque tous de France : précédés d'un essai d'un travail sur la géographie [Paris 1831]
D. Chatry Les Métiers de nos Ancêtres [consultation 08/11/2015]
P. Reymond DICTIONNAIRE des VIEUX METIERS. 1 200 METIERS DISPARUS OU OUBLIÉS
Geneawiki [l'encyclopédie de la généalogie, écrit coopérativement par ses lecteurs.]
XX Les vieux «Mestiers» du bois et de la forêt. [PDF [en ligne]]
Sébastien Bottin Mélanges sur les Langues, Dialectes et Patois, renfermant, entre autres, une collection de versions de la Parabole de l'enfant prodigue en cent idiomes ou patois différens, presque tous de France : précédés d'un essai d'un travail sur la géographie [Paris 1831]

Personne dont le métier consiste à confectionner, à monter, ou à vendre des éventails.
L’éventailliste assemble les feuilles et les montures en bois, nacre, ivoire ou plexi qui sont gravées ou sculptées. Les feuilles de papier ou de tissu sont passées dans la machine à plisser avant d’être décorées. Elles peuvent être aussi de plume ou autre matière synthétique.
provenance du nom :
Dérivé de 'éventail' - composé de 'éventer' (en moyen français 'esventer') et -ail.
thématiques associées : métier en rapport avec l'art artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : bois et écorces cornes,os, ivoire papier textile, fil et laine plastique plumes métal
Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan - Il n’existe aucune formation dédiée au métier d’éventailliste. La transmission du savoir-faire s’effectue par les éventaillistes eux-mêmes dans leurs ateliers.
Références >>

Agent qui est chargé de trier, de distribuer, de remettre à leurs adresses les lettres, objets et valeurs transmis par la poste.
provenance du nom :
« celui qui est chargé d’un négoce pour le compte d’un autre », du latin ‘factor’ (« auteur, créateur, fabricant »).
groupe d'activités : services
milieu de travail : milieu urbain milieu rural milieu naturel métier ambulant
Références >>
Wiktionnaire
Wikipédia - Facteur (métier)
facteurs : mots et maux de Miche [Extraits du livre "Trésors des Postes et Télégraphes", Réalisation : PTT CARTOPHILIE Pierre Jalabert, Rémy Plagnes Association de personnel des PTE Groupement pour la gestion des Activités Sociales de la Poste et de France Télécom]
Wikipédia - Facteur (métier)
facteurs : mots et maux de Miche [Extraits du livre "Trésors des Postes et Télégraphes", Réalisation : PTT CARTOPHILIE Pierre Jalabert, Rémy Plagnes Association de personnel des PTE Groupement pour la gestion des Activités Sociales de la Poste et de France Télécom]



Un artisan spécialisé dans la fabrication et l'entretien d'orgues complets et des nombreuses pièces entrant dans leur construction.
thématiques associées : métier en rapport avec l'art artisanat
groupe d'activités : réparation fabrication et transformation d’objet et produits
milieu de travail : milieu urbain milieu rural
Références >>

Celui, celle qui fabrique ou qui vend de la faïence.
provenance du nom :
(XVIe siècle) De l’italien 'faenza', et, plus avant, de 'Faenza', ville d’Italie, où la faïence fut inventée.
thématiques associées : métier en rapport avec l'art
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
Présence dans le lieu d'exercice : permanente
travaille : pierre, argile et matières rocheuses

Marchand(e) de farine.
provenance du nom :
Du latin 'farīna' (même sens), dérivé de 'far', 'faris' (« froment », « blé », « gruau », « épeautre »).
groupe d'activités : vente

marchand de foin
groupe d'activités : vente
Références >>
Étienne Boileau, Georg Bernhard Depping Réglemens sur les arts et mêtiers de Paris rédiges au XIII siècle - Des Feiniers [Imprimerie de Chapelet, Paris 1837, pp.243-246]
P. Reymond DICTIONNAIRE des VIEUX METIERS. 1 200 METIERS DISPARUS OU OUBLIÉS
D. Chatry Les Métiers de nos Ancêtres [consultation 08/11/2015]
P. Reymond DICTIONNAIRE des VIEUX METIERS. 1 200 METIERS DISPARUS OU OUBLIÉS
D. Chatry Les Métiers de nos Ancêtres [consultation 08/11/2015]

Personne qui fabrique toutes sortes d'objets en fer-blanc, tôle fine d'acier doux, recouverte d'étain.
Le fer-blanc est utilisé en France, dans le mobilier, depuis au moins le XVe siècle. Il servait à former des ferrures de coffre, des chandeliers, des lanternes, des ustensiles de cuisine et de table... Actuellement, il est surtout utilisé pour la confection des boîtes de conserve.
provenance du nom :
de fer-blanc
thématiques associées : artisanat ouvrier
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : métal
Références >>
Wiktionnaire
Wikipédia - Ferblantierr
Métiers d'antan > Métiers des métaux [L’Association pour la Recherche et la Conservation des Outils des Métiers de l'Artisanat (A.R.C.O.M.A.)]
Diderot et d’Alembert Encyclopédie des sciences, des arts et des métiers [(1751-1772)]
MM. Lebrun et F. Malepeyre Nouveau manuel complet du ferblantier et du lampiste, ou L'art de confectionner en fer-blanc tous les ustensiles possibles. [monographie imprimée,Roret,Paris 1849 Bibliothèque nationale de France ]
Wikipédia - Ferblantierr
Métiers d'antan > Métiers des métaux [L’Association pour la Recherche et la Conservation des Outils des Métiers de l'Artisanat (A.R.C.O.M.A.)]
Diderot et d’Alembert Encyclopédie des sciences, des arts et des métiers [(1751-1772)]
MM. Lebrun et F. Malepeyre Nouveau manuel complet du ferblantier et du lampiste, ou L'art de confectionner en fer-blanc tous les ustensiles possibles. [monographie imprimée,Roret,Paris 1849 Bibliothèque nationale de France ]

Le ferronnier est un professionnel du bâtiment, artisan ou ouvrier, qui réalise des éléments architecturaux en fer forgé, appelés ferronneries : mobilier, grilles, garde-corps, rampes d'escalier, charnières et serrures de portes…
thématiques associées : artisanat ouvrier métier en rapport avec le bâtiment
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : métal
Références >>



marchand de fil au détail
provenance du nom :
Du latin ‘filum’.
groupe d'activités : vente
travaille : textile, fil et laine
Références >>

Fabricant de filets.
provenance du nom :
De 'filet' - Diminutif de 'fil' issu du latin 'filum'.
thématiques associées : ouvrier artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : textile, fil et laine

Personne dont le métier est de vendre des fleurs. Le fleuriste compose des bouquets, réalise des assemblages floraux et des arrangements de plantes.
provenance du nom :
Du latin 'flos' (« fleur, partie la meilleure de quelque chose ») via son accusatif 'florem'.
groupe d'activités : vente
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)
Références >>

Pêcheur à la "fouène" (harpon) - notamment dans la pêche à pied.
provenance du nom :
De 'foëne' - Du latin 'fuscina' (« fourche »). Au XIIe siècle : 'foine' (\fwɛn\)
thématiques associées :
groupe d'activités : exploitation et extraction des ressources naturelles
Références >>

Artisan qui fond des cloches, etc.
Au-delà de sa technique métallurgique, la valeur professionnelle du fondeur de cloches est de nature musicale puisqu'il s'agit de savoir façonner le métal - le bronze - de manière que le son, ses harmoniques, correspondent à l'attente du client ou de l'auditoire potentiel
provenance du nom :
De l’ancien français 'sain', cloche.
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : métal
Modalités d'apprentissage : compagnonnage
Témoignage : ...On extrait l’argile en hiver. Le tuilier invitait des amis ou employait quelques journaliers pour extraire la « terre » (l’argile) par pallier. Le trou que l’on creusait n’était pas forcément très grand mais il pouvait être assez profond parfois.
On fabrique les tuiles en été, lorsqu’il n’y a pas de gel, et parce que la température plus clémente rend l’argile plus malléable. L’argile était quand même le plus souvent à fleur du sol, il y avait peu de terre à découvrir. On creusait le premier pallier sur environ 1 à 2 mètres, puis le deuxième et le troisième au maximum mais cela devenait très pénible. On laissait la « terre » sur le côté.
On passe la « terre » dans un broyeur technique vieille de 100 ans au moins, qui casse les cailloux puis dans le malaxeur qui brasse la pâte.
La pâte ressort au bout du malaxeur par une filière qui sert de matrice. Elle donne une forme à la tuile (courbe pour toiture ou tuile faîtière ) ou à la brique (3, 4, 6 ou 9 trous pour cloison ou mur).
On fabriquait également le macaron, une brique réfractaire pour les cheminées avec un moule ainsi qu’une brique réfractaire plus petite d’environ 2 cm d’épaisseur pour les fours à pain.La boule de terre mise dans le malaxeur ressort aplatie grâce à un contrepoids.Pour ne pas abîmer la tuile à la sortie, on utilisait un instrument en bois : le corbet. La tuile était déposée ainsi dans le chariot et mise à sécher dans les claies un certain temps. Le temps de séchage dépendait totalement du climat. Pour optimiser le temps de séchage, les hangars étaient très bas, afin que l’air passe.
Dans toute la commune du Tâtre, on peut voir des traces de trous. En général, ils se bouchaient naturellement avec des végétaux ou avec de l’eau. Ce n’est que très récemment qu’on s’est préoccupé de reboucher les trous formés par l’extraction de la terre.
>la commune du Tâtre,LES TUILERIES DU TÂTRE,
>la commune du Tâtre,LES TUILERIES DU TÂTRE,
Références >>

Responsable de la surveillance du réseau d'un distributeur d’eau, ou, dans les métiers d'art, une personne qui fabrique et entretient les fontaines.
provenance du nom :
Du latin 'aqua fontana' « eau de source », dérivé de 'fons' « source, fontaine » (cf. italien fonte, espagnol fuente, portugais fonte).
groupe d'activités : services

Ouvrier qui travaille le fer au marteau, après l’avoir fait chauffer à la forge. Il se dit principalement de ceux qui font les gros ouvrages de fer, comme barres, ancres, chaînes, instruments aratoires, etc.
Le forgeron est un ouvrier ou artisan professionnel qui forge à la main et assemble des pièces de métal pour réaliser des objets usuels ou entrant dans la composition d'un bâtiment.
Le forgeron est un ouvrier ou artisan professionnel qui forge à la main et assemble des pièces de métal pour réaliser des objets usuels ou entrant dans la composition d'un bâtiment.
provenance du nom :
Du verbe 'forger', qui vient du latin 'fabricare' (« façonner, fabriquer »), et du suffixe -on.
Le mot romain remonte au latin faber « forgeron ».
thématiques associées : artisanat ouvrier
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits réparation
travaille : métal
Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan
Références >>



Celui, qui fait les formes sur lesquelles les cordouaniers font les souliers.
provenance du nom :
(XIe siècle) Du latin 'forma' (« ensemble des caractéristiques extérieures de quelque chose »).
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : bois et écorces
Références >>

L'artisan qui sculpte des blocs de bois de tilleul pour réaliser des formes à chapeaux, bord, calotte, collier pour les modistes et chapeliers.
provenance du nom :
(XIe siècle) Du latin 'forma' (« ensemble des caractéristiques extérieures de quelque chose »).
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : bois et écorces

Personne dont la profession est d'apprêter les peaux, de confectionner des vêtements de fourrure et/ou marchand de fourrures.
Le fourreur utilise les peaux tannées au naturel ou teintes ou rasées. Il associe des techniques de couture mais aussi des procédés propres à la fourrure.
thématiques associées : métier de l’habillement artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
travaille : cuir, fourrures, cheveux
Références >>

Le fripier a pour objectif de réutiliser des vêtements usagés. Il les achète ou les récupère, les nettoie, les répare afin de les revendre. Le fripier doit non seulement assurer la vente, mais il doit également dépouiller les vêtements reçus, faire un tri, les laver et ensuite les mettre en rayon.
provenance du nom :
De l’ancien français 'frepier' (1268), de 'fripe', 'freper' - « chiffoner », issu de 'frepe' (« éffilé; chiffon, vieux habits »), celui-ci issu peut-être du bas-latin 'falappa' (« copeau ») d'origine incertaine, sans doute non latine.
thématiques associées : métier de l’habillement
groupe d'activités : vente ramassage
milieu de travail : milieu urbain milieu rural
travaille : textile, fil et laine
Références >>
Fiche métier : Fripier/fripière [Métiers.be - site d'information belge francophone sur les métiers]
Wiktionnaire
Fripiers, chinchers, brocanteurs de Rouen [La France pittoresque (D’après « Histoire des anciennes corporations d’arts et métiers et des confréries religieuses de la capitale de la Normandie », paru en 1850)]
Wiktionnaire
Fripiers, chinchers, brocanteurs de Rouen [La France pittoresque (D’après « Histoire des anciennes corporations d’arts et métiers et des confréries religieuses de la capitale de la Normandie », paru en 1850)]

Personne qui fabrique, affine ou vend des fromages
provenance du nom :
De 'fromage' avec le suffixe -ier.
'fromage' → Du bas latin *formaticus (caseus), issu de 'forma' (« moule à fromage »)
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
milieu de travail : milieu urbain milieu rural métier ambulant
Présence dans le lieu d'exercice : intermittente,permanente

Celui, celle qui fait métier et profession de vendre du fruit.
groupe d'activités : vente
Références >>

Ouvrier chargé de sécher le sel, employé de la gabelle, agent de la gabelle.
provenance du nom :
De 'gabeler'- De l'ancien français 'gabele', de l'italien 'gabella', de l'arabe 'qabāla', "impôt"
thématiques associées : ouvrier
Références >>
Wiktionnaire
P. Reymond DICTIONNAIRE des VIEUX METIERS. 1 200 METIERS DISPARUS OU OUBLIÉS
Diderot et d’Alembert Encyclopédie des sciences, des arts et des métiers [(1751-1772)]
Frédéric Godefroy Lexique de l’ancien français [H. Champion (Paris,)1990, contributeurs: Jean Bonnard et Amédée Salmon, éditeurs scientifiques, Librairie Honoré Champion ]
P. Reymond DICTIONNAIRE des VIEUX METIERS. 1 200 METIERS DISPARUS OU OUBLIÉS
Diderot et d’Alembert Encyclopédie des sciences, des arts et des métiers [(1751-1772)]
Frédéric Godefroy Lexique de l’ancien français [H. Champion (Paris,)1990, contributeurs: Jean Bonnard et Amédée Salmon, éditeurs scientifiques, Librairie Honoré Champion ]

Personne qui confectionne ou vend des gants.
Avec des peaux tannées, sélectionnées en fonction de leur taille, couleur, grain et souplesse, le gantier coupe les différents éléments du gant à l’aide d’un gabarit et d’une main de fer. Il les assemble à la main ou à la machine, les double et les orne d’accessoires ou de broderies.
provenance du nom :
1197 'wantiere' subst. fém. « femme qui fait ou qui vend des gants, peut-être femme du gantier » (Le nécrologe de la confrérie des jongleurs et des bourgeois d'Arras, éd. R. Berger, 9a); 1241 'wantier' subst masc. « fabricant ou marchand de gants » (Ban de tref. ds Gdf. Compl.); 1260 'gantier' « id. » (E. Boileau, Métiers, éd. G.-B. Depping, p. 240). Dér. de gant*; suff. -ier*, -ière.
thématiques associées : métier de l’habillement artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
travaille : cuir, fourrures, cheveux textile, fil et laine
Références >>

(Depuis 1790) Militaire appartenant à un corps de gendarmerie chargé du maintien de l'ordre et de la sûreté publique, ainsi que de l'exécution des arrêts judiciaires.
provenance du nom :
Univerbation de 'gens d’armes'. En d’autres termes, ce sont des gens portant des armes.
groupe d'activités : services
milieu de travail : milieu urbain milieu rural milieu naturel
Présence dans le lieu d'exercice : permanente
organisation du travail : travail en groupe
Modalités d'apprentissage : autre
Références >>



Marchand de graines ou de grains. Celui qui commercialise des semences, des graines, organes provenant de végétaux et aptes à germer.
provenance du nom :
Composé de 'grenette' (« petite graine ») et -ier avec réfection du radical sur 'grain' et 'graine', les graphies grai-, grè- ayant été en concurrence → voir 'grenu'. Ou composé de 'grenat' et -ier ici au sens étymologique de « de grain », le 'grenetier' en ancien français était un préposé au grenier à sel.
groupe d'activités : vente
Références >>

Le graveur sur pierre creuse le marbre, le granit ou le grès avec une pointe diamantée, au jet de sable ou au gravelet. Il réalise cadrans solaires, plaques funéraires, blasons.
L’art de graver la pierre passe par une connaissance technique de la matière ainsi que par l’étude de la paléographie, et une maîtrise du dessin des lettres.
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : pierre, argile et matières rocheuses
Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan,compagnonnage
Témoignage : Notre processus de fabrication fait la part belle à l’intervention humaine, au savoir-faire manuel, à l’œil expert de l’artisan. Le recours aux machines est limité : nous utilisons des outillages traditionnels en matière de forge, de gravure ou de polissage. Pour autant, le recours aux technologies modernes n’est pas exclu quand celles-ci s’allient au savoir-faire traditionnel pour améliorer la qualité de nos couteaux.
Pour fabriquer un couteau de A à Z, l’artisan coutelier doit maîtriser de multiples savoir-faire. De la forge à la finition, les étapes sont nombreuses et requièrent une expertise propre. Les principales étapes de la production sont la forge, le montage, l’ajustage, le sciage, le façonnage, le ciselage et le polissage.
La forge est la mise en forme du métal. L’acier est chauffé puis forgé par l’artisan pour fabriquer une lame robuste et tranchante. Une fois forgée, la pièce d’acier est de nouveau montée en température puis trempée dans un bain d’huile qui lui confère dureté et élasticité. Nous proposons plusieurs types d’aciers forgés : inox, carbone ou damas.
L’artisan coutelier prépare et ajuste les pièces métalliques du couteau que sont la lame, le ressort, les mitres et les platines. Le ressort forgé est la partie centrale du manche sur laquelle repose la lame lorsque le couteau est fermé. Le couteau est ajusté en position ouverte et fermée afin de garantir son parfait fonctionnement mécanique et le bon maintien de la lame dont le fil ne doit pas être en contact avec le ressort lors de la fermeture.
La fiabilité du couteau dépend de la précision de cet ajustage.
Les matériaux utilisés pour la fabrication des manches sont débités à la main. Nous proposons plusieurs types de matières : bois, cornes et minéraux. Nous n’achetons que des matériaux nobles, de première qualité. D’un couteau à l’autre, l’aspect du manche n’est jamais identique car chaque pièce de matière est unique. Le manche est façonné manuellement.
Le ciselage, aussi appelé guillochage, est l’opération par laquelle le coutelier sculpte les parties métalliques du couteau. Le ressort, les platines peuvent être ciselés. Dans le cas du laguiole, on sculpte aussi la mouche qui orne le ressort.
Le polissage donne son éclat au couteau et révèle la matière du manche. Avant d’être expédié, le couteau est affuté, contrôlé et nettoyé.
>
>

Celui qui fait produire des œufs de vers à soie.
thématiques associées : métier animalier
groupe d'activités : production agricole
Présence dans le lieu d'exercice : permanente

garde en charge de la surveillance des halles
provenance du nom :
De l’allemand ‘Halle’
groupe d'activités : services
milieu de travail : milieu urbain milieu rural
Références >>

Transporteur de sel ou de poissons marins.
provenance du nom :
On donne une étymologie celtique à ce mot : bas-breton, ‘halennour’, marchand de sel ; ‘kimry’, ‘halenw’r ; du bas-breton ou ‘kimry’, ‘halen’, sel.
thématiques associées : ouvrier
groupe d'activités : services
Références >>
P. Reymond DICTIONNAIRE des VIEUX METIERS. 1 200 METIERS DISPARUS OU OUBLIÉS
D. Chatry Les Métiers de nos Ancêtres [consultation 08/11/2015]
Wiktionnaire
Le dictionnaire des citations. [LeMonde.fr]
M. H. de Formeville Notice sur les francs-porteurs de sel de la Ville de Cae [dans "Tableau de Paris" 1782]
D. Chatry Les Métiers de nos Ancêtres [consultation 08/11/2015]
Wiktionnaire
Le dictionnaire des citations. [LeMonde.fr]
M. H. de Formeville Notice sur les francs-porteurs de sel de la Ville de Cae [dans "Tableau de Paris" 1782]

L'éleveur de bovins dont le métier était de faire ré-engraisser, les animaux un peu fatigués provenant d’élevages, avant de les vendre aux abattoirs.
thématiques associées : métier animalier
groupe d'activités : production agricole
milieu de travail : milieu rural
Références >>

Personne qui fait, qui vend, qui répare les des appareils de mesure du temps.
L'horlogerie se compose de deux secteurs : les montres, leurs composants et bracelets, dits horlogerie de "petit volume" et les pendules, pendulettes, réveils, régulateurs, horlogerie monumentale, horloges d'édifices, dits horlogerie de "gros volume". Le mécanisme d'horlogerie est toujours composé d'une force motrice (poids, ressort), d'une transmission (le rouage) et d'une régulation (l'échappement qui rythme le mouvement en unité de temps). Chaque activité requiert un savoir-faire et des outils particuliers et les horlogers se spécialisent.
L'horlogerie se compose de deux secteurs : les montres, leurs composants et bracelets, dits horlogerie de "petit volume" et les pendules, pendulettes, réveils, régulateurs, horlogerie monumentale, horloges d'édifices, dits horlogerie de "gros volume". Le mécanisme d'horlogerie est toujours composé d'une force motrice (poids, ressort), d'une transmission (le rouage) et d'une régulation (l'échappement qui rythme le mouvement en unité de temps). Chaque activité requiert un savoir-faire et des outils particuliers et les horlogers se spécialisent.
provenance du nom :
Dérivé de 'horloge' - Du latin 'horologium' issu du grec ancien ὡρολόγιον hôrológion (de sens identique ; de ὥρα hốra « heure » et de λέγω légô « dire », littéralement : « qui dit l’heure »).
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
Références >>

Un métier des vendanges - portage des hottes, seilles, bennes… (le nom varie selon les régions).
provenance du nom :
Du suisse 'hutte' (« hotte »). Sorte de panier, ouvrage du vannier, qui a des bretelles et qu’on porte sur le dos.
thématiques associées : métier agricole
groupe d'activités : production agricole
milieu de travail : milieu rural
Présence dans le lieu d'exercice : intermittente
organisation du travail : travail en groupe - Dans les pays en pente, on utilise aussi des mulets, bâchés avec deux hottes. Les hotteurs. En bout du carré de vigne vendangé, une charrette attend, dans laquelle le hotteur déverse le contenu de sa hotte. Une ou plusieurs fois par jour selon la taille du vignoble, la charrette va jusqu’au pressoir déverser le raisin par une fenêtre sur le sol nettoyé. Une autre charrette contient de grandes cuves qui prendront, une fois pleines, la direction du cellier pour que le vin rouge y fermente.
Modalités d'apprentissage : apprentissage par le travail
Témoignage : ... J’ai commencé à vendanger à treize ou quatorze ans. Mon grand-père, Ernest Duché, que l’on appelait encore Mativet (surnom hérité de son père, Mathieu), exploitait avec ses trois fils, Louis (mon père), Paul et Marcel, une propriété de 75 000 pieds de vigne à la Jasse de Barry, sur la commune du Cailar, en face le pont de la voie ferrée Arles-Lunel.
Pour enlever la récolte – vingt à vingt-deux jours de boulot – mon grand-père faisait venir une « colle » de la Haute-Loire. Il était en contact avec une personne, prénommée Adèle, qui formait la « colle ». 10 coupeurs (des femmes pour la plupart) et 3 hommes pour vider les seaux et porter ; mon oncle, Marcel, faisant le quatrième homme. Celui qui vidait les seaux le matin, portait l’après-midi et vice-versa.
Les vendangeurs venaient du Puy-en-Velay en train et on allait les chercher avec la charrette et le tombereau à la gare de Vauvert. Ils logeaient au mas dans une grande chambre, couchaient sur la paille et faisaient leur patouille avec les produits et victuailles qu’ils ramenaient de la montagne.
Les vendanges commençaient presque toujours la première semaine de septembre. C’est bien simple, je suis né le 7 septembre et mon grand-père avait coutume de dire « Es arriva in dé la colla ».
On faisait des journées de huit heures. On attaquait à 7h00. On effectuait une bonne battue puis on allait déjeuner vers 8h00. Je salive encore rien que de penser à l’odeur du pâté ou de l’omelette ! Ce moment joyeux et convivial s’accompagnait d’un peu de vin frais, faiblement alcoolisé, remplacé parfois par une fort agréable piquette. On reprenait le travail jusqu’à midi. On s’arrêtait deux heures pour le repas et l’après-midi, on s’activait pendant quatre heures.
Le travail était pénible. En fin de journée, les coupeurs avaient mal aux reins. Le matin quand on ouvrait les feuilles, on était accueilli par une « sympathique » armada de moustiques et l’après-midi on devait supporter une chaleur pesante. La bonbonne d’eau fraiche entourée d’un linge mouillé était alors la bienvenue. Mais tout cela se déroulait dans la bonne humeur, entre rires et chansons.
Les raisins coupés à la serpette étaient amenés du rang à la charrette par les porteurs à l’aide de cornues hissées sur leurs épaules ou sur leur tête. Le tombereau une fois plein était tracté par des chevaux dont je garde encore en mémoire les noms, Bijou, Tambour, Tobby, puis plus tard Coquet, un cheval entier, doté d’une force herculéenne.
Mon père s’occupait des chevaux et du charroi, puis j’ai pris la relève. Mon oncle Paul s’occupait du vin et mon oncle Marcel était dans la vigne avec la « colle ».
>Vendanges chez Emilien Duché
>Vendanges chez Emilien Duché
Références >>



Fabricant et marchand d'huile de table ou d'usage domestique.
Celui qui, lui, traite l'huile.
Propriétaire d'huilerie destinée à la production d'huile végétale et notamment celle de l'huile d'olive.
provenance du nom :
Du latin 'ŏlĕum' (« huile d’olive »), de olea (« olive »). Le h- est un rajout des clercs du Moyen Âge pour éviter la lecture 'vile' (« ville »).
thématiques associées : métier de bouche
groupe d'activités : vente fabrication et transformation d’objet et produits
Références >>

Personne qui imprime des livres, des circulaires, des affiches, etc. L'ouvrier qui travaille à la presse. Une presse est ordinairement servie par deux imprimeurs.
provenance du nom :
Du latin 'imprimere' (« presser sur »).
thématiques associées : ouvrier
groupe d'activités : communication
travaille : papier
organisation du travail : travail en groupe
Références >>

Sculpteur qui travaille l’ivoire.
Autre matériau réglementé, l’ivoire se travaille à sec, parfois à l’eau. L’ivoirier travaille principalement l’ivoire d’éléphant en respectant le sens du fil de cette matière assez dense. Il utilise des scies à chantourner, gouges, râpes, limes, fraises électriques, puis souligne les détails au burin.
thématiques associées : métier en rapport avec l'art artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : cornes,os, ivoire
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé) - Un ivoirier travaille pour l’industrie du luxe (joaillerie, orfèvrerie, lutherie, art de la table…), pour les musées (travaux de restauration) mais surtout pour une clientèle privée (collectionneurs, antiquaires, particuliers) désirant voir sauvées des objets d’art en ivoire et autres matières similaires.
Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan - L’apprentissage ne pourra ainsi se faire qu’exclusivement en atelier d’ivoirier. Rares sont malgré tout de nos jours les ivoiriers à former des apprentis.
Références >>

Personne engagée pour un travail généralement agricole rémunéré à la journée.
Un journalier désignait dans le monde paysan un simple manœuvre ou manouvrier, c'est-à-dire un ouvrier manuel du lieu ou de la contrée, un habitant du pays ouvrier agricole éphémère que l'historiographie contemporaine mentionne communément en pauvre petit paysan louant sa force de travail à la journée auprès d'un maître de domaine ou d'exploitation plus cossue, propriétaire ou fermier entrepreneurs de cultures ou d'élevage. En ce sens, il se distinguait des groupes de saisonniers souvent étrangers ou des migrants divers, parfois recrutés pour des tâches similaires.
Un journalier désignait dans le monde paysan un simple manœuvre ou manouvrier, c'est-à-dire un ouvrier manuel du lieu ou de la contrée, un habitant du pays ouvrier agricole éphémère que l'historiographie contemporaine mentionne communément en pauvre petit paysan louant sa force de travail à la journée auprès d'un maître de domaine ou d'exploitation plus cossue, propriétaire ou fermier entrepreneurs de cultures ou d'élevage. En ce sens, il se distinguait des groupes de saisonniers souvent étrangers ou des migrants divers, parfois recrutés pour des tâches similaires.
provenance du nom :
Le mot français provient du latin médiéval "jornalerius", mot lui-même dérivé du terme polysémique "jornale, jornalis". Il ne faut pourtant retenir que les deux premières acceptions, soient le premier sens d'unité de superficie agraire, le 'jour', le journal ou la 'juchère' médiévale, c'est-à-dire la journée de terre spécifique avec les tâches précises associées selon un calendrier déterminé, et surtout le second sens de travail exigé par un donneur d'ordre ou contraint après appel, c'est-à-dire une corvée si elle n'est pas rémunérée et est due régulièrement à un maître de domaine.
milieu de travail : milieu urbain milieu rural
Présence dans le lieu d'exercice : intermittente
Références >>



Ouvrier procédant à la confection complète des képis.
Fabriquant de képis (ex. casquettes, shakos, calots, turbans, casques).
provenance du nom :
de 'képi' - Coiffure rigide, de forme cylindrique, à fond plat et surélevé, munie d'une visière, portée en France par les officiers et sous-officiers de certaines armes, par certains fonctionnaires et employés et, anciennement, par les écoliers de certains établissements publics.
thématiques associées : métier de l’habillement artisanat ouvrier
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
Références >>

Marchands qui vendent en écheveaux et à la livre les laine.
provenance du nom :
Du latin 'lana' (« laine »), d’un étymon indoeuropéen.
groupe d'activités : vente
travaille : fibres, lianes et brins végétaux
Références >>

Nom donné à celui qui travaille dans une laiterie qui achète et collecte les laits des agriculteurs et qui les redistribue à la population (vendeur et ramasseur de lait).
thématiques associées : métier de bouche
groupe d'activités : vente ramassage
milieu de travail : métier ambulant
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé) - Activité masculine ou féminine, le métier de laitier consistait à vendre le lait produit dans les fermes. Souvent eux-mêmes producteurs, les laitiers se rendaient en ville pour vendre leur lait sur les marchés. L'industrialisation de la production laitière et les techniques de longue conservation ont fait disparaître la profession.
Modalités d'apprentissage : apprentissage par le travail
Références >>



fabricant de lampes et chandeliers
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : métal
Références >>
P. Reymond DICTIONNAIRE des VIEUX METIERS. 1 200 METIERS DISPARUS OU OUBLIÉS
Étienne Boileau, Georg Bernhard Depping Réglemens sur les arts et mêtiers de Paris rédiges au XIII siècle [Paris 183è, p.101-102]
MM. Lebrun et F. Malepeyre Nouveau manuel complet du ferblantier et du lampiste, ou L'art de confectionner en fer-blanc tous les ustensiles possibles. [monographie imprimée,Roret,Paris 1849 Bibliothèque nationale de France ]
Étienne Boileau, Georg Bernhard Depping Réglemens sur les arts et mêtiers de Paris rédiges au XIII siècle [Paris 183è, p.101-102]
MM. Lebrun et F. Malepeyre Nouveau manuel complet du ferblantier et du lampiste, ou L'art de confectionner en fer-blanc tous les ustensiles possibles. [monographie imprimée,Roret,Paris 1849 Bibliothèque nationale de France ]

Personne qui pratique la lavandiculture, qui cultive la lavande.
provenance du nom :
De 'lavande' - (XIIIe siècle) en ancien français lavende, de l’italien 'lavanda' (« lavage, toilette »). La plante donnant une eau parfumée avec laquelle on se lave, on est passé du sens de « eau de toilette », à celui de « fleur d'où cette eau parfumée était extraite ».
thématiques associées : métier agricole
groupe d'activités : production agricole
milieu de travail : milieu rural
organisation du travail : travail en groupe - La cueillette de la lavande est une activité complémentaire réservée aux petits paysans, aux femmes et aux enfants. Elle est vendue aux grassois comme matière première.
Témoignage : ... Ainsi à Marcou , propriété alors d'Emile et Firmin Dauphin , mon père et mon oncle. Ils y cultivaient la lavande , ils en avaient 30 000 pieds et cette lavande était distillée à Aby , campagne distante de 8km de la première. Il n'y avait pas d'eau à Marcou d'où le choix de Aby qui en possédait. (...) La coupe des lavandes se faisait à la main , avec une faucille qu'il fallait affûter chaque jour. ...
>A Marcou, Publié le 31 mai 2011 par Goure
>A Marcou, Publié le 31 mai 2011 par Goure
Références >>

Personne (souvent une femme) qui lavait autrefois le linge essentiellement avec des cendres et de l'eau chaude, puis à la main ou au battoir, dans un cours d'eau ou un lavoir.
provenance du nom :
Du latin ‘lavare’ (« laver »).
thématiques associées : artisanat ouvrier
groupe d'activités : services
milieu de travail : milieu urbain milieu rural milieu naturel
Présence dans le lieu d'exercice : intermittente,permanente
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé),travail en groupe



Ouvrier qui récolte du liège.
Le levage du liège est une activité saisonnière - elle se fait en été, quand la sève est montée (Juin - Août). On lève l’écorce sur tout le tronc et même sur les grosses branches sur les gros chênes.
groupe d'activités : exploitation et extraction des ressources naturelles
milieu de travail : milieu naturel
travaille : bois et écorces
organisation du travail : travail en groupe - La technique du 'levage' (i.e. la levée des écorces de liège des Quercus suber ou chênes-liège) demande beaucoup d’adresse et de patience. Le travail d’écorçage se fait en équipe.
L’écorce de liège peut atteindre jusqu’à 25 cm d’épaisseur. Mais pour lever ou démascler du liège de qualité, il est préférable d’espacer les levées d’au minimum 7 années après l’avoir démasclé c’est à dire avoir enlevé la première écorce qui elle est de qualité inférieure sur des arbres âgés d’une trentaine d’année.
Références >>
Wiktionnaire
XX Le liégeur et le bouchonnier
XX Lièges Junqué [L’entreprise Lièges Junqué réalise le levage sur le chêne-liège de la forêt du massif des Maures puis procède au séchage et au traitement du liège récolté. Les Etablissements Junqué sont certainement la seule exploitation du Sud-Est de la France à travailler encore le liège de façon traditionnelle et à pouvoir proposer un liège de grande qualité « à façon » ou « sur mesure ».]
XX Le liégeur et le bouchonnier
XX Lièges Junqué [L’entreprise Lièges Junqué réalise le levage sur le chêne-liège de la forêt du massif des Maures puis procède au séchage et au traitement du liège récolté. Les Etablissements Junqué sont certainement la seule exploitation du Sud-Est de la France à travailler encore le liège de façon traditionnelle et à pouvoir proposer un liège de grande qualité « à façon » ou « sur mesure ».]

Il fournissait de l’eau et la baignoire. Les livreurs de bain disposaient, au début du XIXe, d’un tonneau d’eau chaude et d’un tonneau d’eau froide ou simplement d’un tonneau d’eau chaude pour les immeubles qui disposaient d’un robinet d’eau froide dans la cour. Le livreur montait la baignoire à dos d’homme puis l’eau à l’aide de seaux sans, bien sûr, rien renverser. Il attendait sur le pallier que le bain soit pris et redescendait baignoire et eaux usées.
Pour porter leur équipement ils se servaient de charrettes à bras ou de voitures attelées.
groupe d'activités : vente
milieu de travail : milieu urbain métier ambulant
Références >>



Celui, celle qui livre des pain de glace.
groupe d'activités : services
milieu de travail : métier ambulant

Un luthier est un artisan qui fabrique, répare et restaure les instruments de musique à cordes pincées ou frottées tels que les violons, altos, violoncelles, violes d'amour, guitares, guitares électriques etc.
provenance du nom :
De 'luth' et -ier.
Emprunté au XIIIe siècle à l’espagnol 'laúd', issu de l’arabe 'al-aoûd', « le bois », et dans un sens particulier « le oud » ou 'luth oriental'. Le l initial vient donc de l'article arabe al tronqué et entendu comme soudé au mot suivant.
thématiques associées : artisanat métier en rapport avec l'art
groupe d'activités : réparation vente fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : bois et écorces métal
Références >>

Les « maquignons » sont les hommes qui achètent des chevaux ruinés et défectueux, qui les rétablissent et qui en couvrent les défauts, pour les vendre plus cher qu’ils ne leur ont coûté.Dans la pratique, le terme est utilisé aussi pour les acheteurs et engraisseurs de bovins.
Le métier de 'maquignon de chevaux' se distingue pourtant des métiers de 'marchand de chevaux'. Il s’agit ici, principalement, de redonner, bonne allure à un animal avant de le revendre à la foire à bon prix.
provenance du nom :
Du néerlandais 'makelen' (« trafiquer »).
thématiques associées : métier animalier
groupe d'activités : vente
milieu de travail : milieu urbain milieu rural
Références >>



Personne qui pratique le maraîchage, c’est-à-dire la culture des fruits et légumes.
Le maraîchage (ou maraichage en orthographe rectifiée), ou horticulture maraîchère ou agriculture maraîchère est la culture de légumes, de certains fruits, de certaines fines herbes et fleurs à usage alimentaire, de manière professionnelle, c'est-à-dire dans le but d'en faire un profit ou simplement d'en vivre, ce qui le distingue du jardinage.
provenance du nom :
(XVe siècle) Dérivé de marais, de l’ancien français mareschier, marequier.
thématiques associées : métier agricole
groupe d'activités : production agricole
milieu de travail : milieu rural
Présence dans le lieu d'exercice : permanente
Références >>



Personne qui s'occupe de griller et la vente des marrons chaudes (la variété du châtaigner comestible).
thématiques associées : métier de bouche
groupe d'activités : vente
milieu de travail : métier ambulant
Présence dans le lieu d'exercice : intermittente
Références >>

Marchand de graisse de porc fondue utilisée pour le graissage des essieux des roues des chariots et carrosses. 'L'oing', qu'on appelle autrement 'axonge', est la graisse la plus molle et la plus humide du corps des animaux.
provenance du nom :
'oing' ou 'oint' - Graisse pour 'oindre' (i.e. frotter d'huile ou d'une matière grasse), provenç. 'onger', 'ogner', 'oingner', 'onher'
groupe d'activités : vente
Références >>
Le Parisien sensagent - dictionnaire [Encyclopédie en ligne, Thesaurus, dictionnaire de définitions et plus. ]
D. Chatry Les Métiers de nos Ancêtres [consultation 08/11/2015]
É. Littré Le Littré - Dictionnaire de la langue française [Il s'agit d'un dictionnaire ancien, paru à la fin du XIXe siècle. Ses vedettes comme ses définitions s'appliquent à une langue française qui a beaucoup évolué en près de 150 ans. Certains passages portent l'empreinte de cette époque et doivent se lire dans ce contexte historique. ]
D. Chatry Les Métiers de nos Ancêtres [consultation 08/11/2015]
É. Littré Le Littré - Dictionnaire de la langue française [Il s'agit d'un dictionnaire ancien, paru à la fin du XIXe siècle. Ses vedettes comme ses définitions s'appliquent à une langue française qui a beaucoup évolué en près de 150 ans. Certains passages portent l'empreinte de cette époque et doivent se lire dans ce contexte historique. ]

Le marchand de fruits et légumes est le détaillant intermédiaire entre les consommateurs finaux et - si il ne pas le producteur lui-même - les producteurs ou les grossistes.
groupe d'activités : vente

Vendeur de tissus qui, suivant la région, été en laine, soie, chanvre, lin, …
groupe d'activités : vente
travaille : textile, fil et laine
Références >>

Vendeurs de soupe 'en détail'. Les marchandes de soupe exerçaient leur métier dans la rue
thématiques associées : métier de bouche
milieu de travail : métier ambulant



Le maréchal-ferrant fabrique et pose les fers aux pieds des équidés et des bovins qui travaillent, pour d’une part protéger d’éventuelles blessures et de l’usure de la corne, et d’autre part pour remédier aux accidents maladies ou anomalies du pied de l’animal.
provenance du nom :
maréchal - e l’ancien français mareschal (« officier des écuries »), du vieux-francique *marhskalk (« palfrenier », « garçon d’écurie ») de mare (« cheval » en ancien français) issu de *markhaz en proto-germanique, mot possiblement d’origine gauloise, et du proto-germain *skalkaz (« serviteur »).
ferrant - du latin *ferrare attesté sous la forme ferratus (« ferré »).
ferrant - du latin *ferrare attesté sous la forme ferratus (« ferré »).
thématiques associées : métier animalier
groupe d'activités : services
Présence dans le lieu d'exercice : permanente
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)
Références >>



Ouvrier qui prépare les peaux de maroquin et de cuir fin ou qui les utilise pour la fabrication d'articles de maroquinerie. Le maroquinier conçoit et fabrique des articles en cuir. Entre tradition et modernité, il perpétue un savoir-faire ancestral tout en adaptant ses modèles aux évolutions de la mode.
Commerçant qui vend des articles de maroquinerie.
Commerçant qui vend des articles de maroquinerie.
thématiques associées : artisanat ouvrier
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
travaille : cuir, fourrures, cheveux
Références >>



Celui, celle qui fait et qui rebat des matelas.
provenance du nom :
De 'matelas' - De l’ancien français 'materas', sans doute issu de l’italien 'materasso' ; issu de l’arabe مطرح, 'maṭraḥ' (« tapis, lieu où l’on jette quelque chose »), dérivé du verbe طرح, 'ṭaraḥa' (« jeter »).
groupe d'activités : réparation fabrication et transformation d’objet et produits
milieu de travail : milieu urbain milieu rural métier ambulant
Références >>

Personne qui prépare les peaux de mouton ou de veau par tannage à l’alun. Le mégissier est un artisan dont le métier est d'accommoder les peaux de mouton ou de veau pour les rendre propres aux différents usages. Ce sont aussi les Mégissiers qui préparent les peaux dont on veut conserver le poil ou la laine, soit pour être employés à faire de grosses fourrures, ou pour d’autres usages.
provenance du nom :
de mégis : la préparation composée d’eau, de cendres et d’alun servant à Mégir c’est à dire blanchir les peaux, de l’ancien français 'mégier' (« soigner ») et lui-même dérivé du bas-latin medicare.
thématiques associées : artisanat ouvrier
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : cuir, fourrures, cheveux
Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan
Références >>

Celui qui réalise des ouvrages de bois pour le bâtiment. Il réalise les portes, les fenêtres, les parquets et boiseries dans le bâtiment, les meubles et les sièges. Il peut également assurer leur pose. Il fournit avant tout une prestation sur mesure en fabrication, mais aussi en agencement en bois massif (de cuisine, de placard) et en petite serrurerie.
provenance du nom :
(1227) De 'menuiser', « travailler le menuise », ce dernier mot signifiant « menu bois », et du latin populaire 'minutiare', « rendre menu ».
Ce mot était originellement réservé à celui qui travaillait les petites pièces de bois, charpentier s’appliquant à celui qui travaillait les grosses pièces.
thématiques associées : métier en rapport avec le bâtiment artisanat
groupe d'activités : services fabrication et transformation d’objet et produits
Présence dans le lieu d'exercice : permanente
travaille : bois et écorces
Modalités d'apprentissage : école (enseignement collectif),compagnonnage - Son métier obéit à des règles précises, transmises longtemps par le compagnonnage et maintenant aussi par des filières professionnelles contrôlées par les pouvoirs publics et les regroupements du métier.
Références >>

Commerçant qui vend de la mercerie - en gros ou au détail - utilisés pour la couture, la confection, les travaux d'aiguilles, la parure.
Les merciers faisaient commerce de produits de luxe : étoffes, objets de toilette, ceintures, franges de robe, bourses, aumônières. Ils n'avaient pas le droit de fabriquer eux-mêmes, mais ils pouvaient enrichir les produits qu'ils vendaient de perles, de pierres précieuses, d'or ou d'argent.
provenance du nom :
De l’ancien français 'merchier' « membre de la mercerie », de 'merz' (« marchandises ») issu du latin 'merx' (« marchandises, denrées »).
thématiques associées : métier de l’habillement
groupe d'activités : vente
travaille : textile, fil et laine
Références >>
portail CNRTL, etymologie
Wiktionnaire
Étienne Boileau Les métiers et corporations de la ville de Paris : XIIIe siècle. [rédigé au temps de Saint Louis vers 1268 par Étienne Boileau, prévôt de Paris, publié par René de Lespinasse et François Bonnardot, Impr. nationale, Paris 1879 ]
Wikipédia - Mercier
Wikipédia - Mercerie
Merciers [La France pittoresque (D’après un texte paru en 1908)]
Wiktionnaire
Étienne Boileau Les métiers et corporations de la ville de Paris : XIIIe siècle. [rédigé au temps de Saint Louis vers 1268 par Étienne Boileau, prévôt de Paris, publié par René de Lespinasse et François Bonnardot, Impr. nationale, Paris 1879 ]
Wikipédia - Mercier
Wikipédia - Mercerie
Merciers [La France pittoresque (D’après un texte paru en 1908)]

Professionnel de la fabrication de farine de céréales ou d'huile, qui possède ou qui exploite un moulin ou une minoterie, personne dont la profession est de fabriquer de la farine de céréales ou de l'huile en utilisant un moulin ou une minoterie.
provenance du nom :
Du latin ‘molinarius’ (« meunier ») - de ‘molina’ (« moulin »)
thématiques associées : artisanat ouvrier
groupe d'activités : services fabrication et transformation d’objet et produits

Celui qui fabrique, répare et vend des miroirs.
provenance du nom :
Du verbe 'mirer', qui vient du latin 'mirare' (« regarder attentivement »). Antoine-Paulin Pihan juge néanmoins plus raisonné de le tirer le mot de l'arabe مرآة, 'mirât' (« miroir »), le mot latin désignant en propre le miroir est speculum, et plutôt que d’avoir à substantiver le verbe 'mirare', le français aurait tiré plus naturellement le nom du prototype arabe existant.
thématiques associées : artisanat ouvrier
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente réparation
travaille : métal verre
Références >>

Celui qui conduit les mulets.
provenance du nom :
De 'mulet' - (XIe siècle) diminutif de l'ancien français 'mul', dérivé du latin 'mulus' « mulet ».
groupe d'activités : services
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)

Personne qui qui cultive des oliviers ou des oléagineux.
On fera ici la différence entre l’oléiculteur et l’oléifacteur. Le premier, qui cultive, n’est généralement pas l’oléifacteur qui, lui, traite l’huile.
provenance du nom :
Du latin oleum (« huile ») et cultor.
thématiques associées : métier agricole
groupe d'activités : production agricole fabrication et transformation d’objet et produits
milieu de travail : milieu rural
Modalités d'apprentissage : école (enseignement collectif),transmission père en fils ou mère en fille
Références >>

Personne qui fabrique et vend des instruments d'optique, en particulier des verres correcteurs pour la vue.
Opticien réalise un examen de la vue, il procède à la réalisation des montages en optique, il taille et adapte les verres compensateurs dans les montures de lunettes). Il conseille ses clients et vend des équipements permettant la compensation des défauts visuels : lunettes de vue, lentilles de contact, loupes, …
provenance du nom :
Nom formé à partir de deux mots grecs: 'optiké' qui signifie 'vision' et 'tekhné' qui signifie 'art, technique'.
D'après son étymologie, ce mot signifie donc "l'art, la technique de la vision"
thématiques associées : artisanat ouvrier
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
Références >>

Artisan qui fabrique et/ou qui vend des objets de parure ou de décoration en métaux précieux finement travaillés, notamment des chandeliers, des couverts, de la vaisselle, des ornements d'église (calices, ciboires, patènes, coffrets et reliquaires).
L'orfèvrerie comporte la fabrication, la transformation ou la restauration d'objets divers liés au culte, à l'usage domestique, à l'ameublement ou l'art de la table.
provenance du nom :
Du latin populaire 'aurifaber' (« forgeron d’or »), composé de 'aurum' (« or ») et 'faber' (« forgeron »), qui donne 'fevre' en ancien français.
Formé, avec or*, sur l'a. fr. fèvre «ouvrier, artisan travaillant le métal, forgeron» (ca 1170, Rois, éd. E. R. Curtius, XIII, 19, p.24), issu du lat. faber «ouvrier, artisan» à la place d'un représentant du lat. aurifex «orfèvre» qui a survécu dans le sud de la France, en Italie et dans la péninsule ibérique (REW3795, FEW t.1, p.181b et t.3, p.342a).
Formé, avec or*, sur l'a. fr. fèvre «ouvrier, artisan travaillant le métal, forgeron» (ca 1170, Rois, éd. E. R. Curtius, XIII, 19, p.24), issu du lat. faber «ouvrier, artisan» à la place d'un représentant du lat. aurifex «orfèvre» qui a survécu dans le sud de la France, en Italie et dans la péninsule ibérique (REW3795, FEW t.1, p.181b et t.3, p.342a).
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
travaille : métal
Références >>

Le papetier est un professionnel du papier, au titre de sa production et de sa commercialisation.
provenance du nom :
De 'papier' et du suffixe masculin -ier, permettant de désigner la personne réalisant un métier - 'papier' du latin 'papyrus', du grec ancien πάπυροç
thématiques associées : artisanat ouvrier
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : papier
Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan,compagnonnage,transmission père en fils ou mère en fille - En général, la papeterie (ou le moulin à papier) est une petite entreprise familiale, exploitée par le propriétaire et ses enfants, avec l’aide d’ouvriers et d’apprentis. Le recrutement est très familial aussi, car on est papetier de père en fils. Les petites papeteries qui n’ont qu’une cuve occupent moins d’une dizaine de personnes. Mais il y a aussi de grosses entreprises, comme celle de Langlée dans la généralité d’Orléans, qui compte 400 ouvriers, ce qui est exceptionnel. En 1739, un arrêt royal impose au monde de la papeterie le système classique du travail : maîtres, compagnons, apprentis, et fixe un certain nombre de règles. L’âge de douze ans est requis pour commencer un apprentissage qui dure quatre ans. On peut ensuite devenir compagnon, pendant quatre ans. On devient enfin maître, en passant un examen devant un jury composé de maîtres papetiers.
Références >>

Celui qui fabrique des parfums. Le créateur de parfums, compositeur parfumeur ou nez.
Il parfumeur mélange différentes essences naturelles ou produits de synthèse qu'il va utiliser en notes de tête, de coeur ou de fond selon son inspiration et les souhaits de son client.
provenance du nom :
Du moyen français ‘perfumer’, formé à partir du latin’per-‘ (« à travers ») et ‘fumare’ (« fumer »), littéralement «couvrir de fumées (bien odorantes)»
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

Celui qui fabrique ou vend des articles servant à embellir les tenues féminines.
Personne qui fabrique ou fait le commerce d'articles de mode ou de fantaisie, destinés à la mode féminine.
Témoignage : ... J’ai commencé à vendanger à treize ou quatorze ans. Mon grand-père, Ernest Duché, que l’on appelait encore Mativet (surnom hérité de son père, Mathieu), exploitait avec ses trois fils, Louis (mon père), Paul et Marcel, une propriété de 75 000 pieds de vigne à la Jasse de Barry, sur la commune du Cailar, en face le pont de la voie ferrée Arles-Lunel.
Pour enlever la récolte – vingt à vingt-deux jours de boulot – mon grand-père faisait venir une « colle » de la Haute-Loire. Il était en contact avec une personne, prénommée Adèle, qui formait la « colle ». 10 coupeurs (des femmes pour la plupart) et 3 hommes pour vider les seaux et porter ; mon oncle, Marcel, faisant le quatrième homme. Celui qui vidait les seaux le matin, portait l’après-midi et vice-versa.
Les vendangeurs venaient du Puy-en-Velay en train et on allait les chercher avec la charrette et le tombereau à la gare de Vauvert. Ils logeaient au mas dans une grande chambre, couchaient sur la paille et faisaient leur patouille avec les produits et victuailles qu’ils ramenaient de la montagne.
Les vendanges commençaient presque toujours la première semaine de septembre. C’est bien simple, je suis né le 7 septembre et mon grand-père avait coutume de dire « Es arriva in dé la colla ».
On faisait des journées de huit heures. On attaquait à 7h00. On effectuait une bonne battue puis on allait déjeuner vers 8h00. Je salive encore rien que de penser à l’odeur du pâté ou de l’omelette ! Ce moment joyeux et convivial s’accompagnait d’un peu de vin frais, faiblement alcoolisé, remplacé parfois par une fort agréable piquette. On reprenait le travail jusqu’à midi. On s’arrêtait deux heures pour le repas et l’après-midi, on s’activait pendant quatre heures.
Le travail était pénible. En fin de journée, les coupeurs avaient mal aux reins. Le matin quand on ouvrait les feuilles, on était accueilli par une « sympathique » armada de moustiques et l’après-midi on devait supporter une chaleur pesante. La bonbonne d’eau fraiche entourée d’un linge mouillé était alors la bienvenue. Mais tout cela se déroulait dans la bonne humeur, entre rires et chansons.
Les raisins coupés à la serpette étaient amenés du rang à la charrette par les porteurs à l’aide de cornues hissées sur leurs épaules ou sur leur tête. Le tombereau une fois plein était tracté par des chevaux dont je garde encore en mémoire les noms, Bijou, Tambour, Tobby, puis plus tard Coquet, un cheval entier, doté d’une force herculéenne.
Mon père s’occupait des chevaux et du charroi, puis j’ai pris la relève. Mon oncle Paul s’occupait du vin et mon oncle Marcel était dans la vigne avec la « colle ».
>Vendanges chez Emilien Duché
>Vendanges chez Emilien Duché
Références >>

Personne qui confectionne ou vend des articles de passementerie, ouvrages tissés ou tressés servant de garniture à l'ameublement et à l'habillement.
Le passementier tisse des galons, franges, rubans en fil, parfois gainés d’or ou d’argent, destinés à la décoration de la maison ou des vêtements. Il utilise une douzaine de métiers (à ratières ou cames) ainsi que d’autres techniques comme le retordage et les finitions à l’aiguille.
Le passementier tisse des galons, franges, rubans en fil, parfois gainés d’or ou d’argent, destinés à la décoration de la maison ou des vêtements. Il utilise une douzaine de métiers (à ratières ou cames) ainsi que d’autres techniques comme le retordage et les finitions à l’aiguille.
provenance du nom :
De 'passement' qui désigne un ruban qui borde les vêtements.
Du latin vulgaire 'passare' (« traverser »), dérivé de 'passus' (« pas »).
thématiques associées : métier de l’habillement artisanat ouvrier
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan,transmission père en fils ou mère en fille
Références >>

Fabricant ou marchand de chapelets et des boutons. Ils travaillaient sur des matières souvent riches, car les chapelets pouvaient faire appel à l'émail, aux perles, à la nacre, à l'ambre, à l'argent, au corail, voire à l'or.
provenance du nom :
Du latin 'pater noster' (« notre père »).
thématiques associées : artisanat ouvrier
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
travaille : céramique bois et écorces verre métal pierre, argile et matières rocheuses cornes,os, ivoire
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé) - Les paternôtriers existent depuis le Moyen Âge, puisque l'on comptait par exemple quatorze d'entre eux à Paris sous le règne de Philippe le Bel.
Les patenôtriers formaient quatre corporations (ou trois confréries.|
Le patenôtrier-émailleur était spécialisé dans l'art de la perle fausse : il imitait l'ambre, le jais, le corail, les perles fines. Des pâtes composées de diverses poudres et mélangées de parfum servaient à faire chapelets et colliers (ceci était interdit à la confrérie des patenôtriers de jais, ambre et corail qui devaient travailler les matières naturelles). Ils mettaient ces globules de pâte en moules, les argentaient et les teignaient pour imiter corail, jais ou ambre.
Références >>
Wiktionnaire
portail CNRTL, etymologie
Wikipéia - Patenôtrier
Étienne Boileau Les métiers et corporations de la ville de Paris : XIIIe siècle. [rédigé au temps de Saint Louis vers 1268 par Étienne Boileau, prévôt de Paris, publié par René de Lespinasse et François Bonnardot, Impr. nationale, Paris 1879 ]
Alfred Franklin Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis le treizième siècle [avec une préface de M. E. Levasseur, H. Welter (Paris), 1906]
Daniela Moisa, Louise Saint-Pierre Roland Ricard, patenôtrier — Le patrimoine immatériel religieux du Québec [Récit de pratique liée à un savoir-faire, La maison de Roland Ricard, 4104, carré des Rouges-Gorges, Québec (Qc), G1G 4J7, 15 août 2010 ]
portail CNRTL, etymologie
Wikipéia - Patenôtrier
Étienne Boileau Les métiers et corporations de la ville de Paris : XIIIe siècle. [rédigé au temps de Saint Louis vers 1268 par Étienne Boileau, prévôt de Paris, publié par René de Lespinasse et François Bonnardot, Impr. nationale, Paris 1879 ]
Alfred Franklin Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis le treizième siècle [avec une préface de M. E. Levasseur, H. Welter (Paris), 1906]
Daniela Moisa, Louise Saint-Pierre Roland Ricard, patenôtrier — Le patrimoine immatériel religieux du Québec [Récit de pratique liée à un savoir-faire, La maison de Roland Ricard, 4104, carré des Rouges-Gorges, Québec (Qc), G1G 4J7, 15 août 2010 ]

Celui, celle qui fait de la pâtisserie ou qui tient commerce de pâtisserie. Le métier de pâtissier est souvent couplé à d'autres activités proches : boulanger, chocolatier, confiseur, glacier, voire traiteur.
provenance du nom :
Du verbe 'pâtisser' - en ancien français 'pasticier' (« faire des pâtés, de la pâtisserie »), apparenté à 'pastis', 'pâte'.
thématiques associées : métier de bouche artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan,école (enseignement collectif) - Le pâtissier débute sa carrière comme apprenti, puis passe par le stade d’ouvrier, de responsable d’équipe ou devient commerçant indépendant.
Références >>
Wiktionnaire
Wikipédia - Pâtissier
Pâtissier / Pâtissière : études, diplômes, salaire, formation [CIDJ - Association loi 1901 placée sous le haut patronage du Ministère de la Jeunesse et des Sports a été créée en 1969 pour que tous les jeunes aient un accès égal à l’information nécessaire à leur autonomie. ]
Pâtissiers, oublayeurs, feuriers et nieuliers en Normandie [La France pittoresque (D’après « Histoire des anciennes corporations d’arts et métiers et des confréries religieuses de la capitale de la Normandie », paru en 1850)]
Laurent Bonneau Oublayeurs, feuriers et nieuliers [SOCIÉTÉ DES COMPAGNONS BOULANGERS, PÂTISSIERS RESTÉS FIDÈLES AU DEVOIR, Source « Histoire des anciennes corporations d’arts et métiers et des confréries religieuses de la capitale de la Normandie », paru en 1850.]
Sébastien Durand Histoire de la pâtisserie des origines à nos jours 9 - Le 19e siècle [Du Sacré au Sucré, un blog de bon goût !]
Wikipédia - Pâtissier
Pâtissier / Pâtissière : études, diplômes, salaire, formation [CIDJ - Association loi 1901 placée sous le haut patronage du Ministère de la Jeunesse et des Sports a été créée en 1969 pour que tous les jeunes aient un accès égal à l’information nécessaire à leur autonomie. ]
Pâtissiers, oublayeurs, feuriers et nieuliers en Normandie [La France pittoresque (D’après « Histoire des anciennes corporations d’arts et métiers et des confréries religieuses de la capitale de la Normandie », paru en 1850)]
Laurent Bonneau Oublayeurs, feuriers et nieuliers [SOCIÉTÉ DES COMPAGNONS BOULANGERS, PÂTISSIERS RESTÉS FIDÈLES AU DEVOIR, Source « Histoire des anciennes corporations d’arts et métiers et des confréries religieuses de la capitale de la Normandie », paru en 1850.]
Sébastien Durand Histoire de la pâtisserie des origines à nos jours 9 - Le 19e siècle [Du Sacré au Sucré, un blog de bon goût !]

Ouvrier spécialisé dans la pose de pavé. Il prépare l'assise et effectue les différentes opérations de pavage de chaussées et de trottoirs.
provenance du nom :
Du latin ‘pavire’ (« battre (la terre), aplanir, niveler »), qui donne ‘pavir’.
groupe d'activités : services
milieu de travail : milieu urbain milieu rural milieu naturel
travaille : pierre, argile et matières rocheuses

Celui qui pratique la pêche professionnellement.
provenance du nom :
Dérivé de 'pêcher' avec le suffixe -eur. (1677) Du latin populaire 'piscare' (latin classique piscari), « pêcher ». (1190) peskier.
thématiques associées : métier de la mer
groupe d'activités : exploitation et extraction des ressources naturelles
milieu de travail : milieu naturel
Témoignage : "J'ai débuté le métier de pêcheur à l'âge de 14 ans avec mon père et mes deux frères Joseph et Pierre, à bord d'une belle catalane à voile latine surnommée La Mascotte. C'était unmétier très pénible où l'on souffrait des intempéries. Le physique de l'homme était fréquemment mis à l'épreuve : à cette époque (1930), les filets étaient en coton! Dès que l'on rentrait de la pêche après avoir effectué la pesée du poisson que l'on avait démaillé au préalable, on étendait les filets sur le sol de la jetée du Boutigué afin qu'ils sèchent au soleil. Quant aux filets troués, on les ravaudait avec des navettes en bois (sorte d'aiguille) et du fil.Très souvent l'opération de ravaudage se déroulait en famille avec ma mère Marthe. L'apparition du moteur a apporté une amélioration au niveau du labeur. En 1932, nous avons acheté une barque que l'on a baptisée La Marthe, en hommage à ma mère. Elle était équipée d'un moteur Baudouin 5,7. On possédait également une petite barque 'Les 3 Frères'. On pratiquait toutes sortes de techniques de pêche : des nasses aux filets... Les pêcheurs connaissaient parfaitement les fonds marins, ils savaient se repérer en mer. Par exemple, en se servant d'amers (point fixe sur la côte servant de repère), on connaissait notre position sans avoir besoin de cartes marines. Après la seconde guerre mondiale, un bateau a coulé 'Le Bananier', de nos jours, de nombreux plongeurs descendent vers les abysses afin de pouvoir l'apercevoir. Pour accéder au Bananier, on prenait l'axe de la jetée du phare par rapport à la tour des Douanes du Faubourg et lorsqu'on voyait le Fort Béar aligné au Cap Roig, on était certain d'y être dessus.
>François Mateu, Collioure, Mémoire d'un pêcheur.
>François Mateu, Collioure, Mémoire d'un pêcheur.
Références >>



courrier à pied, dans le midi, homme qu’on envoyé pour en appeler autre
provenance du nom :
De l’occitan ‘pedon’ (« piéton »)
groupe d'activités : communication services
Références >>

Artisan qui fabrique des peignes.
provenance du nom :
Du latin 'pecten' qui a donné 'pigne' en ancien français.
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : cornes,os, ivoire bois et écorces
Références >>

Personne qui cultive, sélectionne, développe les plants en pépinière ou qui dirige une pépinière.
Le pépiniériste produit et élève des végétaux d’extérieur, surtout des arbres et arbustes (fruitiers, forestiers, d’ornement). Il en assure le développement afin de les vendre. Il peut se spécialiser dans un type de plantations.
provenance du nom :
De 'pépinière' - «terrain où se font les semis d'arbres» dér. de 'pépin'
thématiques associées : métier agricole
groupe d'activités : production agricole vente
Présence dans le lieu d'exercice : permanente
Références >>
portail CNRTL, etymologie
Pépiniériste [CIDJ -Association loi 1901 placée sous le haut patronage du Ministère de la Jeunesse et des Sports a été créée en 1969 pour que tous les jeunes aient un accès égal à l’information nécessaire à leur autonomie. ]
Fiches métiers › Pépiniériste [ouestfrance-emploi.com]
Pépiniériste [CIDJ -Association loi 1901 placée sous le haut patronage du Ministère de la Jeunesse et des Sports a été créée en 1969 pour que tous les jeunes aient un accès égal à l’information nécessaire à leur autonomie. ]
Fiches métiers › Pépiniériste [ouestfrance-emploi.com]

Celui qui conçoit, fabrique, entretient et pose des perruques ou des postiches.
provenance du nom :
De ‘perruque’ - peut-être emprunté à l’italien ‘parrucca’. Étant donné la polysémie du moyen français ‘perruque’ et la rareté relative de son équivalent italien ‘parrucca’ au XVIe siècle, il semblerait que le mot soit français.
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
milieu de travail :
travaille : cuir, fourrures, cheveux plastique
Témoignage : ...On extrait l’argile en hiver. Le tuilier invitait des amis ou employait quelques journaliers pour extraire la « terre » (l’argile) par pallier. Le trou que l’on creusait n’était pas forcément très grand mais il pouvait être assez profond parfois.
On fabrique les tuiles en été, lorsqu’il n’y a pas de gel, et parce que la température plus clémente rend l’argile plus malléable. L’argile était quand même le plus souvent à fleur du sol, il y avait peu de terre à découvrir. On creusait le premier pallier sur environ 1 à 2 mètres, puis le deuxième et le troisième au maximum mais cela devenait très pénible. On laissait la « terre » sur le côté.
On passe la « terre » dans un broyeur technique vieille de 100 ans au moins, qui casse les cailloux puis dans le malaxeur qui brasse la pâte.
La pâte ressort au bout du malaxeur par une filière qui sert de matrice. Elle donne une forme à la tuile (courbe pour toiture ou tuile faîtière ) ou à la brique (3, 4, 6 ou 9 trous pour cloison ou mur).
On fabriquait également le macaron, une brique réfractaire pour les cheminées avec un moule ainsi qu’une brique réfractaire plus petite d’environ 2 cm d’épaisseur pour les fours à pain.La boule de terre mise dans le malaxeur ressort aplatie grâce à un contrepoids.Pour ne pas abîmer la tuile à la sortie, on utilisait un instrument en bois : le corbet. La tuile était déposée ainsi dans le chariot et mise à sécher dans les claies un certain temps. Le temps de séchage dépendait totalement du climat. Pour optimiser le temps de séchage, les hangars étaient très bas, afin que l’air passe.
Dans toute la commune du Tâtre, on peut voir des traces de trous. En général, ils se bouchaient naturellement avec des végétaux ou avec de l’eau. Ce n’est que très récemment qu’on s’est préoccupé de reboucher les trous formés par l’extraction de la terre.
>la commune du Tâtre,LES TUILERIES DU TÂTRE,
>la commune du Tâtre,LES TUILERIES DU TÂTRE,
Références >>

Celui qui préparait et vendait des médicaments.
provenance du nom :
Dérivé de ‘pharmacie’ - Du latin ‘pharmacia’ (« ensemble des médicaments »).
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
milieu de travail : milieu urbain milieu rural
Modalités d'apprentissage : école (enseignement collectif)
Références >>



Professionnel qui pratique la photographie, qui en fait son métier.
Commerçant qui exécute et vend des portraits photographiques, qui vend des appareils photographiques et leurs accessoires, et qui se charge du développement et du tirage des photographies d'amateur.
Commerçant qui exécute et vend des portraits photographiques, qui vend des appareils photographiques et leurs accessoires, et qui se charge du développement et du tirage des photographies d'amateur.
provenance du nom :
Du grec ancien φωτός, ‘phôtós’, génitif singulier de φῶς, ‘phỗs’ (« lumière »).
thématiques associées : métier en rapport avec l'art
groupe d'activités : services
milieu de travail : milieu urbain milieu rural milieu naturel

Le pipier fabrique par tournage et façonnage des pipes en bois. Il découpe des racines de bruyère ou ébauchons, les trempe pour "tuer" la sève et éviter que le bois ne se fende. Il ébauche le foyer, la tige et par injection de sable, fait ressortir les veines les plus dures.
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : bois et écorces
Modalités d'apprentissage : transmission père en fils ou mère en fille

Personne qui fait le commerce du poisson au détail. Il est l'intermédiaire entre le pêcheur - ou l'éleveur - et le cuisinier ou le consommateur. Son travail comprend la transformation, la conservation et l'inspection de ses produits et le service à la clientèle.
provenance du nom :
De ancien français 'peis', 'pois', 'pescion' (« poisson »), du latin 'piscem'.
thématiques associées : métier de bouche
groupe d'activités : vente
Références >>



Gardien de sécurité employé dans la police, dont la fonction est de faire respecter la loi, de maintenir l'ordre et d'assurer la sécurité publique.
la police municipale - engagée et payée par la municipalité (fonctionnaire) ;
la police nationale - engagée et payée par l'État (fonctionnaire) ;
provenance du nom :
Du latin ‘politia’ (« organisation politique, gouvernement de la cité »), lui-même du grec ancien πολιτεία, ‘politeía’ ; il est passé du sens de « bon ordre, bonne administration » à celui, plus restreint, de « ensemble des règles à suivre » puis « administration veillant au bon ordre ».
groupe d'activités : services
milieu de travail : milieu urbain
Présence dans le lieu d'exercice : permanente
organisation du travail : travail en groupe
Modalités d'apprentissage : autre
Références >>



Celui, celle qui fait, qui vend des pots et de la vaisselle de terre cuite. Le potier fabrique ses articles soit à l'aide d'un tour ou à la main, en utilisant différentes qualités de terre et en variant les températures pour la cuisson.
provenance du nom :
Mot composé de 'pot' (XI) et -ier.
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
travaille : pierre, argile et matières rocheuses
Références >>
portail CNRTL, etymologie
J.Y.Blaise, I.Dudek, W.Komorowski, T.Węcławowicz Architectural transformations on the Market Square in Krakow - A systematic visual catalogue [AFM Publishing House / Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2016]
J.Y.Blaise, I.Dudek, W.Komorowski, T.Węcławowicz Architectural transformations on the Market Square in Krakow - A systematic visual catalogue [AFM Publishing House / Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2016]



Il propose ses services aux particuliers, agriculteurs, professionnels pour venir à domicile presser les fruits de leurs vergers.
thématiques associées : métier de bouche
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
milieu de travail : milieu rural métier ambulant
Présence dans le lieu d'exercice : intermittente
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)

Celui, celle qui tient un commerce de quincaillerie - un type de commerce de détail, destiné au professionnel ou au particulier, vendant principalement des outils, des fournitures et matériel de bricolage (visserie, serrurerie…), ou des ustensiles ménagers.
provenance du nom :
'kincaillier' Dér. de 'quincaille' - « objets, ustensiles de fer, de cuivre »
groupe d'activités : vente
Références >>

Fonctionnaire préposé à la capture des chiens errants et à leur transport à la fourrière.
thématiques associées : métier animalier
groupe d'activités : services ramassage
milieu de travail : métier ambulant
Références >>

Réparer un filet de pêche dont des mailles sont coupées.
provenance du nom :
De 'ramender' avec le suffixe -eur.
Composé de re- et 'amender' - du latin 'emendare' (« corriger, amender »).
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : réparation
Références >>



Une personne, généralement qualifiée, chargée de nettoyer les cheminées. Il utilise de longs balais-brosses ou une raclette (genre de truelle) pour enlever la suie du conduit.
provenance du nom :
De l’ancien français ‘ramoner’ (« balayer »), ‘ramon’ (« balai »).
groupe d'activités : services
Témoignage : Notre processus de fabrication fait la part belle à l’intervention humaine, au savoir-faire manuel, à l’œil expert de l’artisan. Le recours aux machines est limité : nous utilisons des outillages traditionnels en matière de forge, de gravure ou de polissage. Pour autant, le recours aux technologies modernes n’est pas exclu quand celles-ci s’allient au savoir-faire traditionnel pour améliorer la qualité de nos couteaux.
Pour fabriquer un couteau de A à Z, l’artisan coutelier doit maîtriser de multiples savoir-faire. De la forge à la finition, les étapes sont nombreuses et requièrent une expertise propre. Les principales étapes de la production sont la forge, le montage, l’ajustage, le sciage, le façonnage, le ciselage et le polissage.
La forge est la mise en forme du métal. L’acier est chauffé puis forgé par l’artisan pour fabriquer une lame robuste et tranchante. Une fois forgée, la pièce d’acier est de nouveau montée en température puis trempée dans un bain d’huile qui lui confère dureté et élasticité. Nous proposons plusieurs types d’aciers forgés : inox, carbone ou damas.
L’artisan coutelier prépare et ajuste les pièces métalliques du couteau que sont la lame, le ressort, les mitres et les platines. Le ressort forgé est la partie centrale du manche sur laquelle repose la lame lorsque le couteau est fermé. Le couteau est ajusté en position ouverte et fermée afin de garantir son parfait fonctionnement mécanique et le bon maintien de la lame dont le fil ne doit pas être en contact avec le ressort lors de la fermeture.
La fiabilité du couteau dépend de la précision de cet ajustage.
Les matériaux utilisés pour la fabrication des manches sont débités à la main. Nous proposons plusieurs types de matières : bois, cornes et minéraux. Nous n’achetons que des matériaux nobles, de première qualité. D’un couteau à l’autre, l’aspect du manche n’est jamais identique car chaque pièce de matière est unique. Le manche est façonné manuellement.
Le ciselage, aussi appelé guillochage, est l’opération par laquelle le coutelier sculpte les parties métalliques du couteau. Le ressort, les platines peuvent être ciselés. Dans le cas du laguiole, on sculpte aussi la mouche qui orne le ressort.
Le polissage donne son éclat au couteau et révèle la matière du manche. Avant d’être expédié, le couteau est affuté, contrôlé et nettoyé.
>
>
Références >>



Celui, celle dont le métier est de relier les livres. La fonction du relieur est de protéger le livre, de l’embellir, d’augmenter sa durée de vie et de faciliter sa consultation. L’habillage d’un livre s’envisage en fonction de son usage futur qui définit trois grands types de reliure : la reliure courante, la reliure d’art et la restauration de reliure
groupe d'activités : réparation fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : papier cuir, fourrures, cheveux fibres, lianes et brins végétaux
Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan
Témoignage : ...On extrait l’argile en hiver. Le tuilier invitait des amis ou employait quelques journaliers pour extraire la « terre » (l’argile) par pallier. Le trou que l’on creusait n’était pas forcément très grand mais il pouvait être assez profond parfois.
On fabrique les tuiles en été, lorsqu’il n’y a pas de gel, et parce que la température plus clémente rend l’argile plus malléable. L’argile était quand même le plus souvent à fleur du sol, il y avait peu de terre à découvrir. On creusait le premier pallier sur environ 1 à 2 mètres, puis le deuxième et le troisième au maximum mais cela devenait très pénible. On laissait la « terre » sur le côté.
On passe la « terre » dans un broyeur technique vieille de 100 ans au moins, qui casse les cailloux puis dans le malaxeur qui brasse la pâte.
La pâte ressort au bout du malaxeur par une filière qui sert de matrice. Elle donne une forme à la tuile (courbe pour toiture ou tuile faîtière ) ou à la brique (3, 4, 6 ou 9 trous pour cloison ou mur).
On fabriquait également le macaron, une brique réfractaire pour les cheminées avec un moule ainsi qu’une brique réfractaire plus petite d’environ 2 cm d’épaisseur pour les fours à pain.La boule de terre mise dans le malaxeur ressort aplatie grâce à un contrepoids.Pour ne pas abîmer la tuile à la sortie, on utilisait un instrument en bois : le corbet. La tuile était déposée ainsi dans le chariot et mise à sécher dans les claies un certain temps. Le temps de séchage dépendait totalement du climat. Pour optimiser le temps de séchage, les hangars étaient très bas, afin que l’air passe.
Dans toute la commune du Tâtre, on peut voir des traces de trous. En général, ils se bouchaient naturellement avec des végétaux ou avec de l’eau. Ce n’est que très récemment qu’on s’est préoccupé de reboucher les trous formés par l’extraction de la terre.
>la commune du Tâtre,LES TUILERIES DU TÂTRE,
>la commune du Tâtre,LES TUILERIES DU TÂTRE,
Références >>

Le rémouleur est la personne qui aiguise les ustensiles coupants et tranchants des ménagères ou des commerçants, mais aussi dans le passé, les poignards et les épées des gentilshommes, sur une petite meule ambulante qu'il tourne avec ses pieds.
provenance du nom :
De l’ancien français 're- émoudre' (« aiguiser sur la meule »).
groupe d'activités : services réparation
milieu de travail : milieu urbain milieu rural métier ambulant
Présence dans le lieu d'exercice : intermittente
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé) - Cet artisan ambulant passait deux fois par an, au printemps et à l'automne. Il poussait sa carriole dans laquelle étaient installés ses meules de grès de différentes finesses de grain. Deux pédales en bois animaient une grande roue à gorge qui servait de volant. Ce dernier entraînait rapidement les pierres à aiguiser rotatives. Au-dessus de la meule, un petit réservoir rempli d’eau permettait de mouiller le grès pendant la phase d’aiguisage. Pour redresser les lames tordues, notre amoulaire avait fixé sur son banc une toute petite enclumette ainsi qu’un gros marteau. Un toit léger abritait l'ensemble et le rémouleur était assis sur une planche qui lui servait de banc.
Références >>

Personne qui s'occupe du paillage des chaises.
Le rempaillage ou cannage de sièges, chaises, fauteuils... consiste à prendre de la paille ou un autre matériau pour refaire la partie de l'objet où l'on s'assoit (l'assise).
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : réparation
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)
Références >>

Le réparateur de faïence perçait des trous au burin de part et d'autre de la cassure pour maintenir les tessons de céramique avec des fils de métal (fer, laiton, cuivre) formant des agrafes.
Pour maintenir en place le métal dans l'orifice pratiqué,il le colmatait avec du mastic de vitrier La faïence était réparée avec de la colle et des attaches en fil de fer.
groupe d'activités : réparation
milieu de travail : milieu urbain milieu rural
travaille : céramique
Références >>

Les rétameurs faisaient du porte à porte pour collecter les cuillères, fourchettes, louches, casseroles et tous autres objets de ferblanterie pour leur rendre l'éclat qui leur manquait après maintes et maintes utilisations. Ils allumaient leur brasero à l'abri d'une grande tôle et activaient le brasier avec un soufflet de cuir, ils faisaient fondre de l'étain dans un grand chaudron en fonte. Ils nettoyaient les objets à rénover dans divers bains, certainement dégraissants ou acidulés, puis les frottaient énergiquement à l'aide de fines brosses ou bien de chiffons.
Le rétameur quant à lui enlève l'ancien étain afin de le refaire à neuf. Il rebouche les trous des fonds de casseroles et ustensiles en fer blanc.
provenance du nom :
De 'étamer', dénominal de 'étain'.
L'étamage est l'action de déposer une couche d'étain (d'un autre métal ou d'un alliage) sur un ustensile, casserole, couvert, clou, bouton... afin d'en empêcher l'oxydation.
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : réparation
milieu de travail : milieu urbain milieu rural métier ambulant
travaille : métal
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)
Références >>



Celui, celle qui a la spécialité de faire rôtir les viandes et celui, celle qui vend des viandes rôties ou prêtes à rôtir.
provenance du nom :
De l’ancien français 'rostir' - lui-même du germanique 'raustjan'.
thématiques associées : métier de bouche
groupe d'activités : vente fabrication et transformation d’objet et produits
Références >>

Le sabotier est la personne qui est spécialisée dans la fabrication des sabots.
Les sabotiers se répartissaient en deux catégories: les planeurs qui façonnaient l'extérieur du sabot et les creuseurs qui réalisaient l'intérieur.
provenance du nom :
De l’ancien français 'çabot', inflexion de 'bot' (« botte »), de 'savate' (« soulier »), de l’ancien occitan 'sabata', du turc 'zabata', de l’arabe 'sabbât' (« sandale »)
thématiques associées : métier de l’habillement artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
milieu de travail : milieu rural milieu naturel
Présence dans le lieu d'exercice : permanente
travaille : bois et écorces
Modalités d'apprentissage : transmission père en fils ou mère en fille - Fabriquer un sabot n'est pas une tâche aisée et l'apprentissage est long. L'apprenti "creuse" et "finit" pendant quatre ou cinq mois, ensuite il taille pendant deux ans. Les apprentis étaient souvent fils de sabotier. Traditionnellement le père transmettait son métier à ses enfants, comme le montre l'exemple Freulon où l'artisanat du bois s'est poursuivi sur plusieurs générations.



Le santonnier façonne les petites figurines qui peuplent les crèches de Noël. Il sculpte dans de l'argile rouge, verte ou blanche, le modèle original. Cette matrice sert à l'obtention d'une réplique identique du santon, voire à des reproductions en série, à partir d'un moule. Le santonnier peint son personnage ou l’orne de costumes si nécessaire.
provenance du nom :
De l’occitan 'santon' (« petit saint », « statuette représentant les personnages de la Nativité et destinée à une crèche ») dérivé de 'sant' (« saint »).
thématiques associées : métier en rapport avec l'art artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
travaille : pierre, argile et matières rocheuses
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)
Modalités d'apprentissage : transmission père en fils ou mère en fille - Il n’existe pas de formation au métier de santonnier d’art. Beaucoup d’entreprises sont familiales et le savoir-faire se transmet au sein de la famille.
Références >>



Celui qui recueille le sel. Un travailleur récoltant le sel dans des marais salant. Le mot de « saunier » désigne aussi historiquement les récoltants de sel travaillant dans des sauneries, où ils obtenaient le sel en chauffant l'eau sur des feux de bois.
Marchand de sel. les sauniers étaient des vendeurs de sel, et en raison des impôts élevés sur ce produit, notamment la gabelle, ils devaient faire face à la concurrences des « faux-saulniers », vrais marchands faisant de la contrebande.
Marchand de sel. les sauniers étaient des vendeurs de sel, et en raison des impôts élevés sur ce produit, notamment la gabelle, ils devaient faire face à la concurrences des « faux-saulniers », vrais marchands faisant de la contrebande.
provenance du nom :
(1260) Du latin salinarius (« de saline »), devenu salinier, saulnier, saunier. (1138) salnier.
groupe d'activités : exploitation et extraction des ressources naturelles vente
organisation du travail : travail en groupe - Le maître-saunier, employé permanent ou patron, se distingue des simples manœuvres, le plus souvent saisonniers.
Références >>

Fabricant de savon.
provenance du nom :
Du latin 'saponem', accusatif de 'sapo' « savon ».
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
Modalités d'apprentissage : transmission père en fils ou mère en fille
Références >>

Celui qui fait, qui vend des selles.
Le bourrelier travaille la bourre et le cuir : c’est de la peau tannée de bœuf, veau, chèvre, âne ou mouton.
provenance du nom :
Du latin 'sella' (« siège »), apparenté à 'silla' en espagnol.
La principale matière travaillée par le bourrelier est le cuir de boeuf ou de vache qui, lorsqu'il est de bonne qualité, est le plus résistant. Pour certaines pièces, il utilisait parfois le cuir de mouton. Le bourrelier devait aussi utiliser différents tissus, toiles caoutchoutées, moleskine. Pour fabriquer les colliers, il devait également travailler le bois et utiliser des clous, rivets, ferrures et autres pièces de métal, ainsi que de la bourre (poils d'animaux ou fillase de chanvre) - d'où le nom de ce métier.
La principale matière travaillée par le bourrelier est le cuir de boeuf ou de vache qui, lorsqu'il est de bonne qualité, est le plus résistant. Pour certaines pièces, il utilisait parfois le cuir de mouton. Le bourrelier devait aussi utiliser différents tissus, toiles caoutchoutées, moleskine. Pour fabriquer les colliers, il devait également travailler le bois et utiliser des clous, rivets, ferrures et autres pièces de métal, ainsi que de la bourre (poils d'animaux ou fillase de chanvre) - d'où le nom de ce métier.
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : bois et écorces

Celui qui fabrique un instrument à vent appelé « serpent » réalisé en bois recouvert de cuir en forme de serpent.
Le serpent a longtemps accompagné le chant liturgique et le chœur dont il renforçait la partie grave lors des offices religieux. Il fut donc, pendant plus de deux siècles, essentiellement voué au soutien des formations vocales religieuses.
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : bois et écorces cuir, fourrures, cheveux métal
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)
Références >>

Artisan ou ouvrier qui fabrique, pose et répare les serrures, qui les ajuste aux portes et aux meubles, qui les entretient et les répare.
Objets fabriqués : clefs, heurtoirs, serrures
provenance du nom :
Du verbe 'serrer' issu du bas-latin 'serare' (« fermer avec une barre ») et suffixe -ure. 'Serare' est lié au substantif latin 'sera' (« barre de clôture », « serrure », « verrou mobile », « cadenas »).
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits réparation
travaille : métal
Références >>

Personne qui recherche de l'eau souterraine en utilisant une baguette ou un pendule.
provenance du nom :
De ‘source’- Ancien participe passé féminin substantivé de sourdre (masculin : sours), issu du bas latin ‘sursus’, simplification du latin classique 'surrectus’ du participe de ‘surgere’ (« surgir »).
groupe d'activités : services
Présence dans le lieu d'exercice : intermittente
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)

cultivateur de tabac
provenance du nom :
De 'tabac' avec le suffixe -culteur.
'tabac'- de l’espagnol 'tabaco' qui est un emprunt de l’arawak de Cuba et Haïti. Pendant le XVIe siècle, le mot espagnol est emprunté tel quel en français en concurrence avec pétun, issu du tupi. Dès le début du XVIIe, la forme tabac s’impose.,
thématiques associées : métier agricole
groupe d'activités : production agricole
Présence dans le lieu d'exercice : permanente
organisation du travail : travail en groupe

marchand de tabac
provenance du nom :
De ‘tabac’ - De l’espagnol ‘tabaco’ qui est un emprunt de ’arawak’ de Cuba et Haïti. Pendant le XVIe siècle, le mot espagnol est emprunté tel quel en français en concurrence avec ‘pétun’, issu du ’tupi’. Dès le début du XVIIe, la forme ‘tabac’ s’impose.
groupe d'activités : vente
travaille : textile, fil et laine
Références >>

Artisan fabriquant des limes par martelage de barres d'acier doux.
Tailleur de limes, (Taillandiers.) ce sont les mêmes que parmi les maîtres taillandiers de la communauté de Paris; on les nomme taillandiers - vrilliers. Ils ont le nom de tailleurs de limes, parce qu'entr'autres ouvrages ils taillent & coupent les limes d'acier de diverses hachures, avant que de les tremper. On les appelle vrilliers, parce que les vrilles, petits outils de menuisiers, sont du nombre de ceux qu'ils fabriquent.
Tailleur de limes, (Taillandiers.) ce sont les mêmes que parmi les maîtres taillandiers de la communauté de Paris; on les nomme taillandiers - vrilliers. Ils ont le nom de tailleurs de limes, parce qu'entr'autres ouvrages ils taillent & coupent les limes d'acier de diverses hachures, avant que de les tremper. On les appelle vrilliers, parce que les vrilles, petits outils de menuisiers, sont du nombre de ceux qu'ils fabriquent.
provenance du nom :
du latin 'lima', qui se rapporte à 'limus', "oblique", à cause de l'obliquité ou de la courbure des stries de la lime
thématiques associées : artisanat ouvrier
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : métal
Références >>

Le tailleur de pierre est un professionnel du bâtiment, artisan ou compagnon, qui réalise des éléments architecturaux en pierre de taille : murs, arcs, linteaux, plate-bande, voûtes, piliers, etc.
Son domaine professionnel est la taille de pierre. Le tailleur de pierre assure également la pose de ses appareils sur le bâtiment. Il peut être amené à monter sur des échafaudages. Il travaille en atelier ou sur les chantiers.
Le tailleur de pierre possède l’art de la coupe des pierres : la stéréotomie. Il peut intervenir dans toutes les phases de travail : de l'extraction de la pierre à la pose. Il doit tirer le meilleur parti d'un bloc venant de la carrière pour réaliser des éléments tels que des linteaux, des arcades, des voûtes, des façades, des socles, des cheminées, des éléments d'escalier ou de fenestrage. Relevé, esquisse, calepinage, pose ou ravalement sont les activités qu’il est amené à exercer.
Le tailleur de pierre possède l’art de la coupe des pierres : la stéréotomie. Il peut intervenir dans toutes les phases de travail : de l'extraction de la pierre à la pose. Il doit tirer le meilleur parti d'un bloc venant de la carrière pour réaliser des éléments tels que des linteaux, des arcades, des voûtes, des façades, des socles, des cheminées, des éléments d'escalier ou de fenestrage. Relevé, esquisse, calepinage, pose ou ravalement sont les activités qu’il est amené à exercer.
thématiques associées : métier en rapport avec le bâtiment
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits exploitation et extraction des ressources naturelles
travaille : pierre, argile et matières rocheuses
Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan,école (enseignement collectif),compagnonnage
Références >>

Celui qui taille des vignes.
thématiques associées : métier agricole
groupe d'activités : production agricole
milieu de travail : milieu rural

Personne dont le métier est de tanner des cuirs, de vendre des cuirs tannés.
provenance du nom :
Dénominal de 'tan' et -er, voir l’occitan 'tanar', de même sens.
thématiques associées : artisanat ouvrier
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
Présence dans le lieu d'exercice : permanente
travaille : cuir, fourrures, cheveux
Références >>

Le tapissier d’ameublement est l’héritier des artisans du Moyen-âge qui confectionnaient des courtines (rideaux) et des courtepointes (couvertures piquées) ou qui posaient des tentures et des tapisseries. Aujourd’hui, il façonne tout ce qui touche à la décoration textile d'un espace intérieur. Le tapissier d'ameublement réalise et pose des tentures, voilages et rideaux sur les murs (tentures murales, draperies), fenêtres (rideaux, voilages, lambrequins et bandeaux), sols (moquettes, tapis) ou plafonds (vélums, plafonds tendus ou plissés). Il confectionne aussi des literies et autres coussins. Le tapissier doit aussi savoir garnir et habiller (gainage) des meubles (sièges, canapés, fauteuils, literies, portes, placards…).
provenance du nom :
Du latin 'tapes' (« tapis, housse de cheval »).
Le terme de Tapissier, dérivé de « Tapiz » (mot d’origine byzantine), qui sert à désigner indifféremment ceux qui créent, qui fabriquent des tapisseries ou des tapis, qui exécutent des ensembles décoratifs, qui utilisent tous les textiles et cuirs, tous contribuant au confort et à la décoration des intérieurs.
Le terme de Tapissier, dérivé de « Tapiz » (mot d’origine byzantine), qui sert à désigner indifféremment ceux qui créent, qui fabriquent des tapisseries ou des tapis, qui exécutent des ensembles décoratifs, qui utilisent tous les textiles et cuirs, tous contribuant au confort et à la décoration des intérieurs.
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : réparation fabrication et transformation d’objet et produits
Présence dans le lieu d'exercice : permanente
travaille : fibres, lianes et brins végétaux textile, fil et laine
Références >>

Ouvrier ou artisan qui tisse de la toile. Celui qui fait du tissage, qui fabrique un tissu en entrelaçant deux séries de fils : la chaîne qui forme le support, et la trame qui passe entre les fils de la chaîne.
provenance du nom :
'tisseur' - de 'tisser', avec le suffixe -eur qui sert à former des noms de métiers.
'tisserand' - (XIIIe siècle) De l’ancien français 'tissier' (« tisserand ») avec la finale germanique -anc[1] avec un d non-étymologique comme dans allemand et normand
'tisserand' - (XIIIe siècle) De l’ancien français 'tissier' (« tisserand ») avec la finale germanique -anc[1] avec un d non-étymologique comme dans allemand et normand
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
milieu de travail : milieu urbain milieu rural
travaille : textile, fil et laine
Références >>



personne dont le métier est de tondre des animaux (ex. moutons)
thématiques associées : métier animalier
groupe d'activités : services
Présence dans le lieu d'exercice : intermittente
Modalités d'apprentissage : apprentissage par le travail - C'est en tondant qu'on devient tondeur.
Références >>

Le tondeur de draps est l'ouvrier ou artisan qui travaille dans les manufacture des lainages, à tondre les étoffes avec les grands ciseaux qu'on nomme forces.
Celui qui lustre et lisse les étoffes et les draps pour les rendre plus unis et plus ras. Ce travail était effectué à l'aide de ciseaux d'un poids de 18 kg. Les premières machines de tondage sont apparues vers 1820.
Celui qui lustre et lisse les étoffes et les draps pour les rendre plus unis et plus ras. Ce travail était effectué à l'aide de ciseaux d'un poids de 18 kg. Les premières machines de tondage sont apparues vers 1820.
thématiques associées : ouvrier
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
Présence dans le lieu d'exercice : permanente
travaille : textile, fil et laine
organisation du travail : travail en groupe
Références >>



Artisan qui fabrique et répare les tonneaux (et parfois d'autres ustensiles en bois, baquets, cuveaux, etc.).
Le tonnelier utilise le plus fréquemment du chêne pour la fabrication d'un tonneau. Le bois est d'abord préparé par un merrandier en douelles, qui seront assemblées, chauffées et resserrées à l'aide de cercles en fer. Sont ensuite insérées les pièces de fond, puis le trou de bonde et de broquereau percés.
provenance du nom :
De 'tonnel' et -ier
Tonneau, par l'intermédiaire de 'tonnel' ; bourg. 'tonnelé' ; wallon, 'tonnlî'.
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : services fabrication et transformation d’objet et produits
milieu de travail : milieu rural
Présence dans le lieu d'exercice : permanente
travaille : bois et écorces
organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé) - D'abord appelé charpentier de tonneau, les maîtres tonneliers étaient déjà réunis en corporation au IXe siècle. Au XIIIe siècle, ils remirent leurs statuts pour approbation en même temps que 121 autres corps de métiers.
En 1444, Charles VII de France confirma les statuts des tonneliers ou barilliers (les tonneliers charpentiers ou foudriers ont pour leur part été rattachés à la corporation des charpentiers dès le Xe siècle). Il donne par la même occasion aux tonneliers barilliers le privilège de déchargeurs de vin : ils sont les seuls à avoir le droit de débarquer le vin qui arrive par bateau.
Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan - Il n'y en a qu'une et elle offre en principe une insertion professionnelle immédiate.
Références >>

Le torpilleur de rue est la personne responsable de l'évacuation des ordures et des vidanges des seaux d'aisance.
Les toupines devaient être sorties juste avant le passage du torpilleur, c'est-à-dire, au petit matin, dès que l'aube pointait. Le ramassage des ordures ménagères s'effectuait au moyen d'un tombereau tiré par un cheval et l'employé affecté à ce travail ingrat, armé d'une énorme pelle plate et d'un balai de bruyère, avait pour tâche de vider les poubelles et enlever les petits tas d'ordures accumulés par les balayeurs de rue avant son passage.
thématiques associées : ouvrier
groupe d'activités : services
milieu de travail : milieu urbain



Le tourneur sur bois réalise grâce à un tour des objets en bois et donne forme à la pièce en utilisant des ciseaux d’acier ou une gouge qui pénètrent le bois
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : services fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : bois et écorces

Celui, celle qui vend des tripes, des abats provenant des espèces bovines, ovines et porcines. Cuisseur et vendeur des tripes.
thématiques associées : métier de bouche
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente
Références >>

Ouvrier qui fait des tuiles.
thématiques associées : métier en rapport avec le bâtiment
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : pierre, argile et matières rocheuses
organisation du travail : travail en groupe - une activité saisonnière
Témoignage : ...On extrait l’argile en hiver. Le tuilier invitait des amis ou employait quelques journaliers pour extraire la « terre » (l’argile) par pallier. Le trou que l’on creusait n’était pas forcément très grand mais il pouvait être assez profond parfois.
On fabrique les tuiles en été, lorsqu’il n’y a pas de gel, et parce que la température plus clémente rend l’argile plus malléable. L’argile était quand même le plus souvent à fleur du sol, il y avait peu de terre à découvrir. On creusait le premier pallier sur environ 1 à 2 mètres, puis le deuxième et le troisième au maximum mais cela devenait très pénible. On laissait la « terre » sur le côté.
On passe la « terre » dans un broyeur technique vieille de 100 ans au moins, qui casse les cailloux puis dans le malaxeur qui brasse la pâte.
La pâte ressort au bout du malaxeur par une filière qui sert de matrice. Elle donne une forme à la tuile (courbe pour toiture ou tuile faîtière ) ou à la brique (3, 4, 6 ou 9 trous pour cloison ou mur).
On fabriquait également le macaron, une brique réfractaire pour les cheminées avec un moule ainsi qu’une brique réfractaire plus petite d’environ 2 cm d’épaisseur pour les fours à pain.La boule de terre mise dans le malaxeur ressort aplatie grâce à un contrepoids.Pour ne pas abîmer la tuile à la sortie, on utilisait un instrument en bois : le corbet. La tuile était déposée ainsi dans le chariot et mise à sécher dans les claies un certain temps. Le temps de séchage dépendait totalement du climat. Pour optimiser le temps de séchage, les hangars étaient très bas, afin que l’air passe.
Dans toute la commune du Tâtre, on peut voir des traces de trous. En général, ils se bouchaient naturellement avec des végétaux ou avec de l’eau. Ce n’est que très récemment qu’on s’est préoccupé de reboucher les trous formés par l’extraction de la terre.
>la commune du Tâtre,LES TUILERIES DU TÂTRE,
>la commune du Tâtre,LES TUILERIES DU TÂTRE,
Références >>

Personne qui mène paître les vaches, les bovins, qui les garde, les soigne et s’en occupe.
provenance du nom :
Du latin populaire *vaccarius, de 'vacca' (« vache »).
thématiques associées : métier animalier
groupe d'activités : production agricole



Celui qui travaille l'osier pour fabriquer des corbeilles, des vans, etc. Il tresse l'osier comme le tisserand la laine, pour produire des mannes et des paniers de toutes sortes, pour tous les métiers et pour l'usage domestique.
provenance du nom :
Le terme de 'vannerie' est apparu au XIIIème siècle ; il vient du mot "van" qui désigne un panier plat aux bords relevés, muni de 2 poignées qui permettait de séparer le grain de la paille.
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
milieu de travail : milieu urbain milieu rural
travaille : fibres, lianes et brins végétaux
Références >>



Pêcheur de tortues à la varre.
provenance du nom :
Le mot de 'varre' est espagnol, il signifie une gaule ou perche ; celle dont on se sert en cette pêche, est de sept à huit piés de longueur, d'un bon pouce de diamètre, à-peu-près comme la hampe d'une hallebarde.
thématiques associées : métier de la mer
groupe d'activités : exploitation et extraction des ressources naturelles
milieu de travail : milieu naturel

Fabricant de vaisselle en bois de hêtre.
thématiques associées : artisanat
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : bois et écorces

Celui, celle qui cueille les raisins, qui aide à faire les vendanges.
thématiques associées : métier agricole
groupe d'activités : production agricole
milieu de travail : milieu rural
Présence dans le lieu d'exercice : intermittente
organisation du travail : travail en groupe
Modalités d'apprentissage : courte instruction
Références >>



Un métier d'art exercé par un artisan d'art ou un artiste, chargé de fabriquer ou restaurer des objets décoratifs en verre (vitrail, figurines, sculptures) ou utilitaires (art de la table, verrerie spécifique).
thématiques associées : métier en rapport avec l'art artisanat ouvrier
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
travaille : verre

Une personne qui cultive la vigne et ses raisins, et transforme lui-même ces derniers en vin.
provenance du nom :
Du latin vīnĕa (« vignoble », « cep de vigne », « pied de vigne »). Vigne se dit en latin vītis, ce qui explique l’étymologie des mots savants viticulture, viticole, etc.
thématiques associées : métier agricole métier de bouche
groupe d'activités : production agricole fabrication et transformation d’objet et produits
milieu de travail : milieu rural
Présence dans le lieu d'exercice : permanente
Références >>

Celui qui fait et vend du vinaigre (souvent dans les régions viticoles en marge des productions "nobles").
provenance du nom :
De 'vinaigre' - univerbation, de 'vin' et 'aigre'.
groupe d'activités : vente fabrication et transformation d’objet et produits

Personne qui s'occupe de la viniculture, de la fabrication du vin.
thématiques associées : métier de bouche
groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits
Présence dans le lieu d'exercice : permanente
Références >>

celui qui cultive la vigne, arbrisseau sarmenteux cultivé pour son fruit
thématiques associées : métier agricole
groupe d'activités : production agricole
milieu de travail : milieu rural
Présence dans le lieu d'exercice : permanente
Références >>

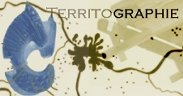













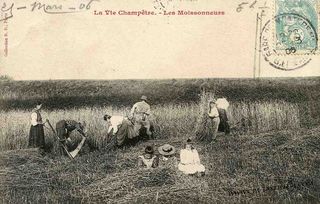
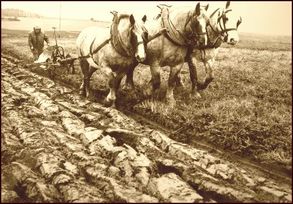


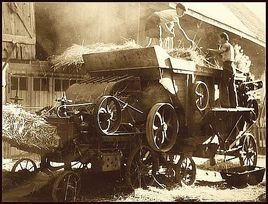

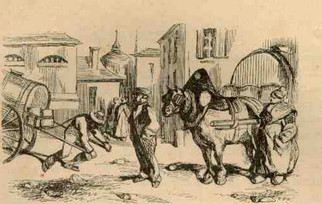
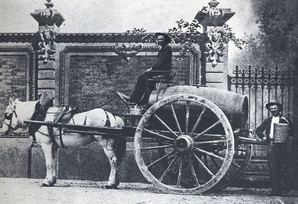
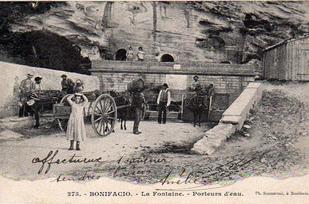






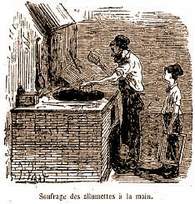


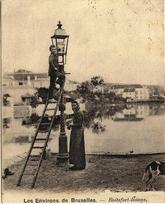


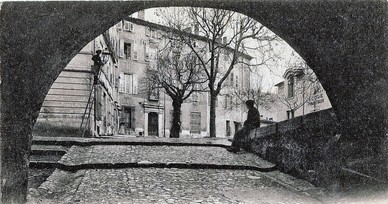




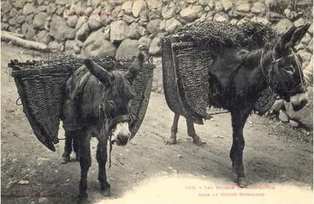


.jpg)
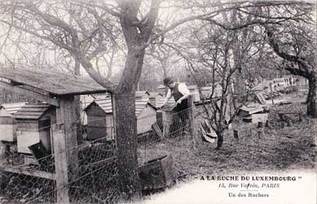







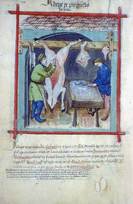
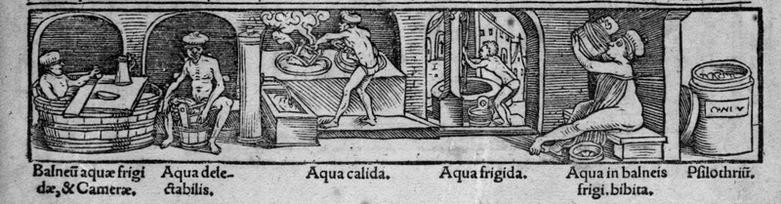
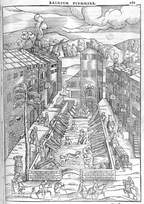

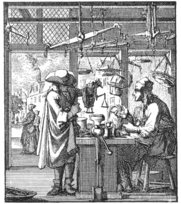





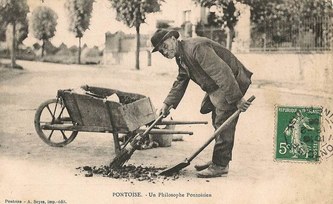



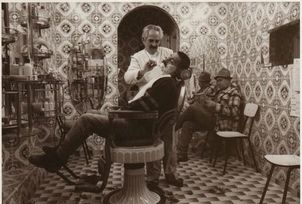
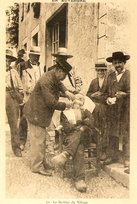









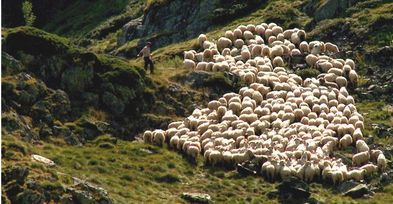
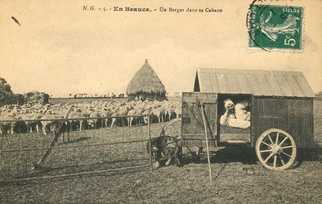




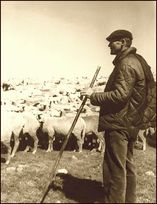



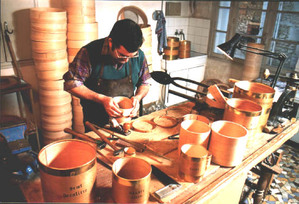







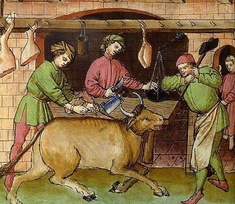
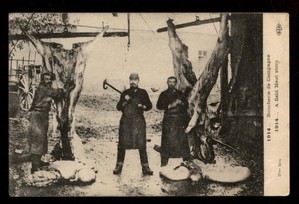





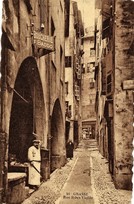

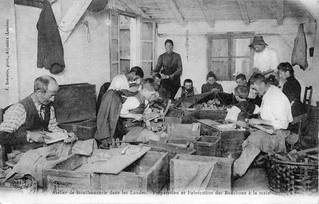


_-_Ouvrières_Tourneuses_à_la_machine_(Mézin,_Lot-et-Garonne).jpg)
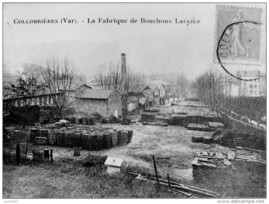


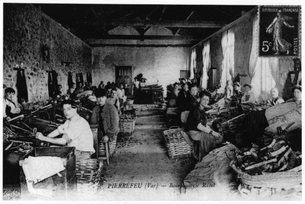





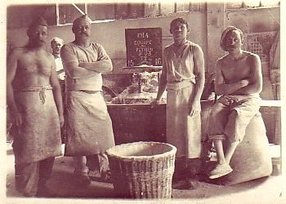



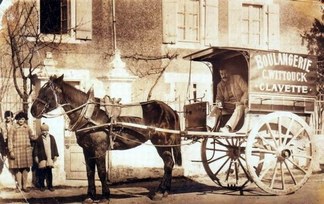

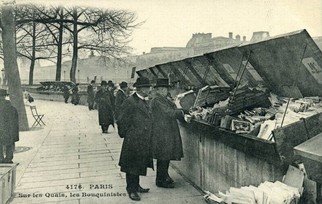

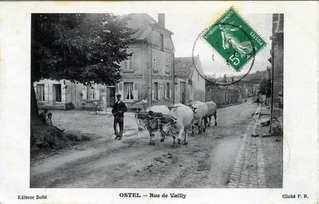
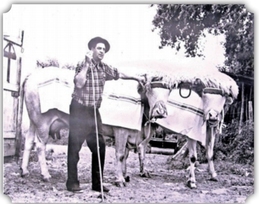

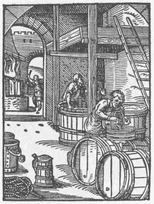



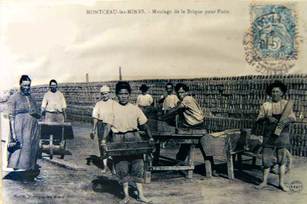
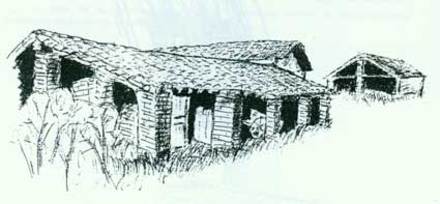
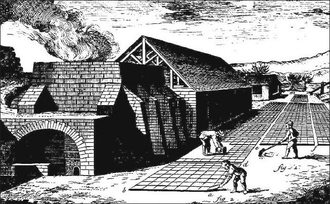

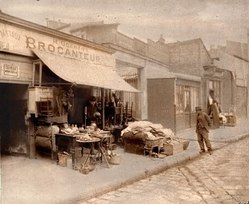









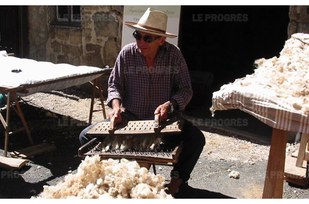




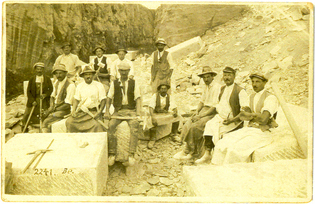












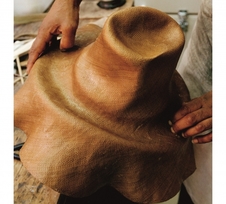


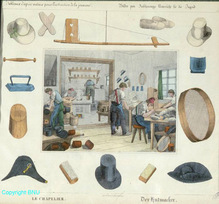
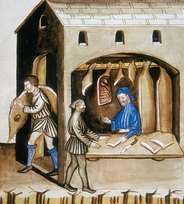
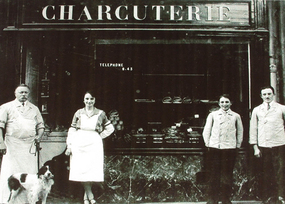






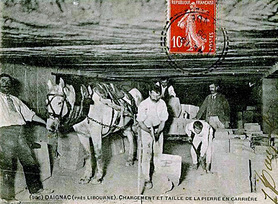




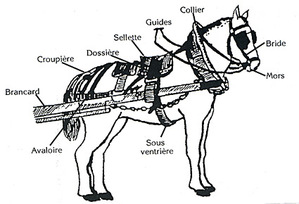
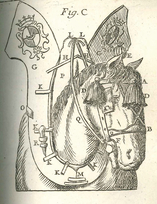

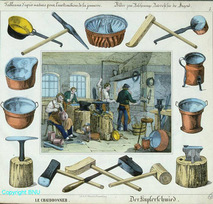



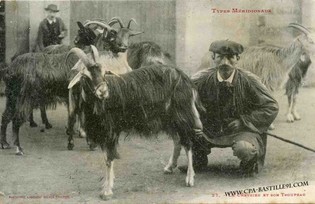
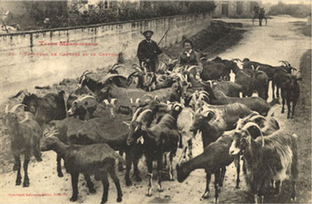
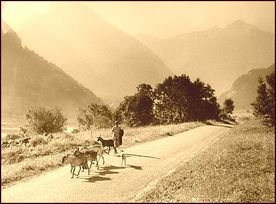
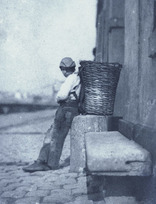


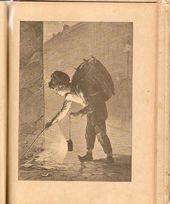




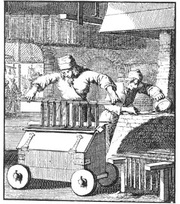









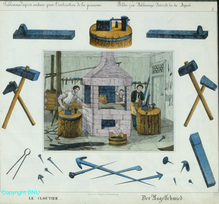

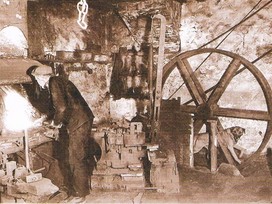






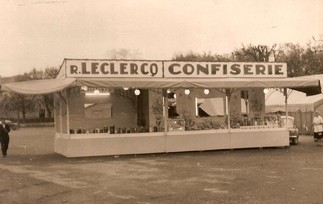
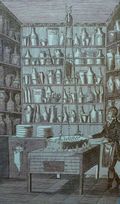
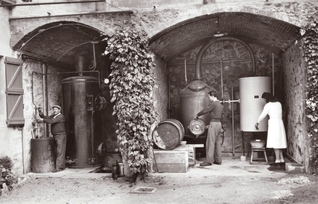



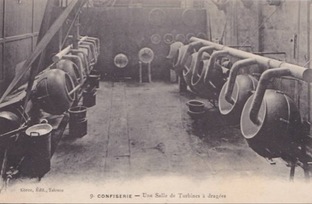


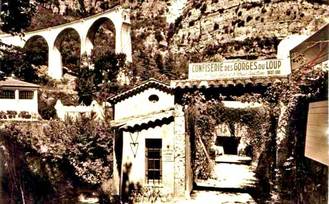

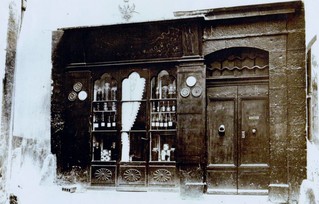



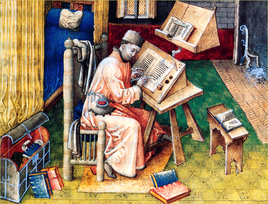
.jpg)
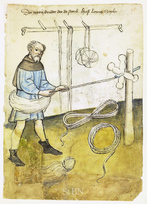






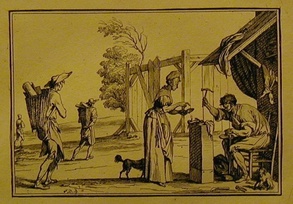


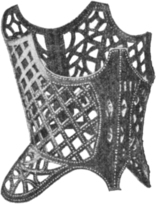
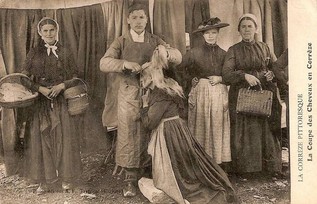



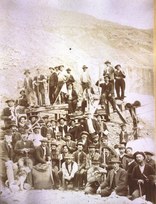
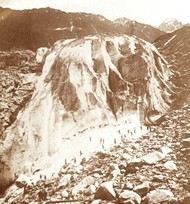


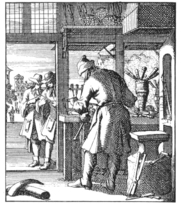
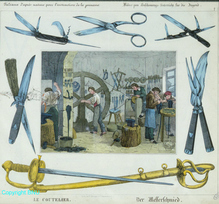




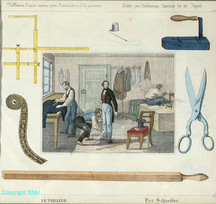


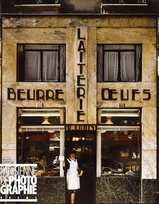

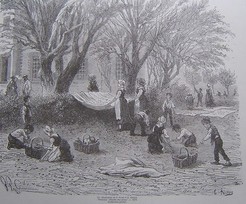

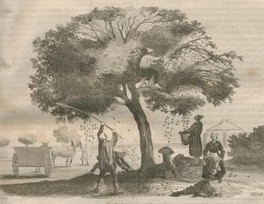


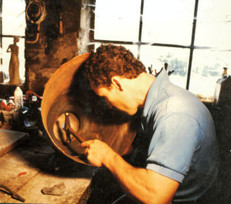







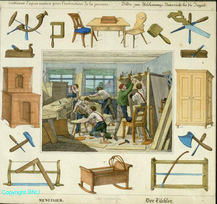



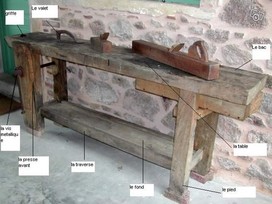

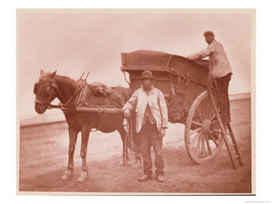

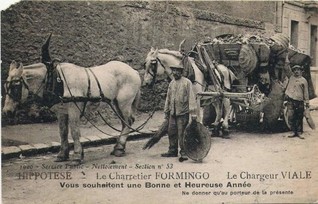
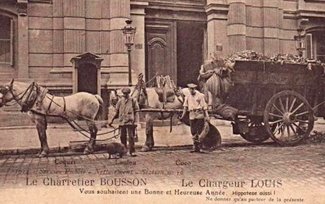
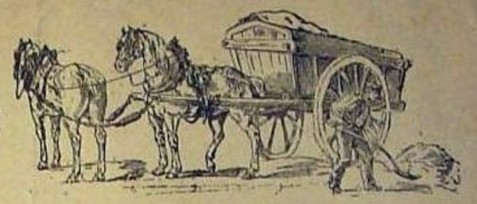











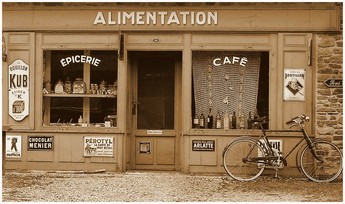

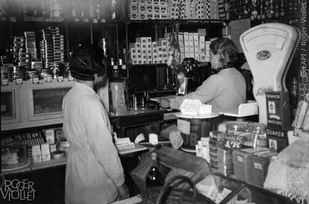
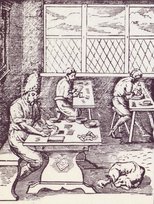
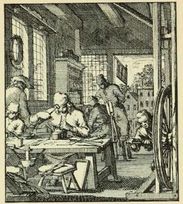




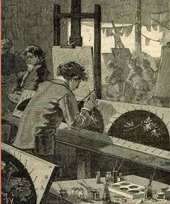





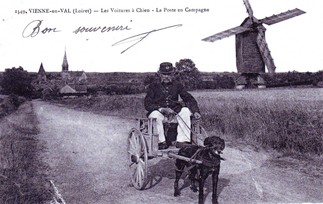

.jpg)






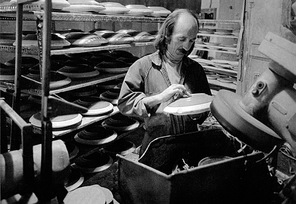


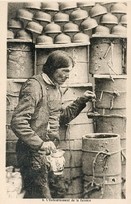
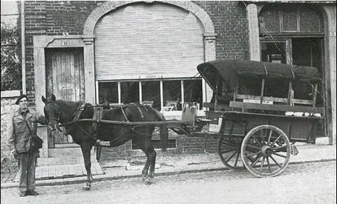



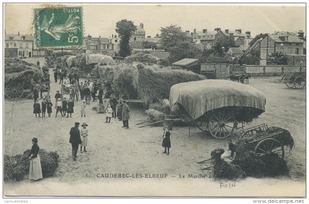
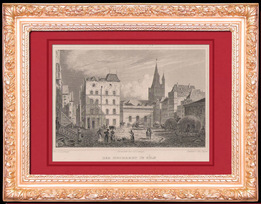















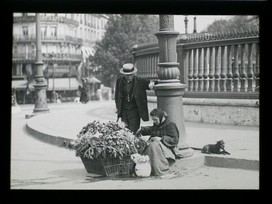
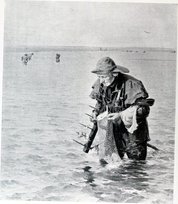












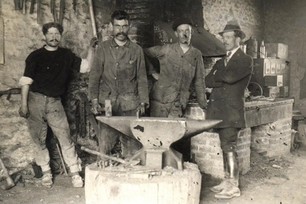






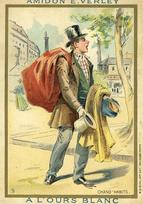
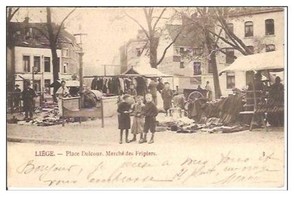
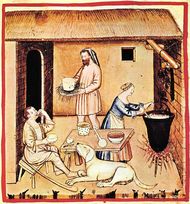



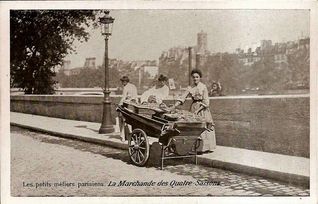

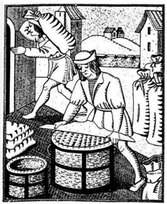
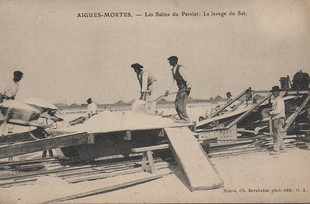
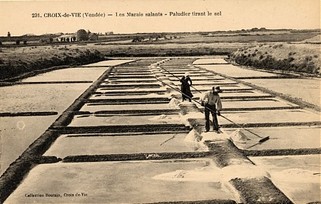
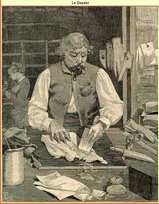




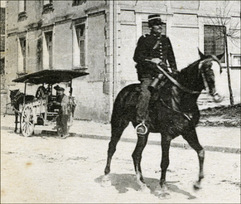







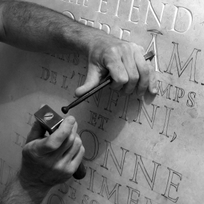





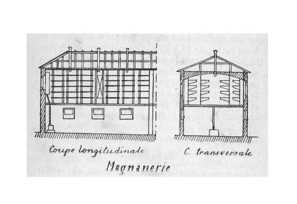
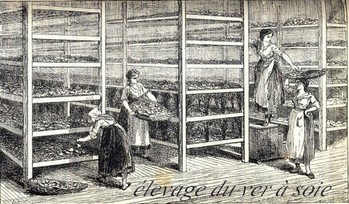

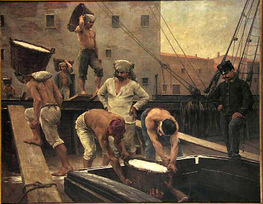
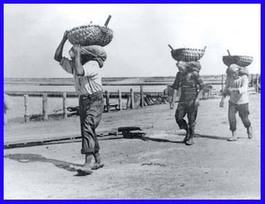
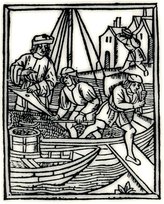

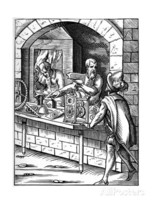






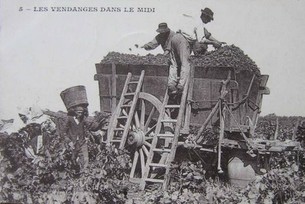
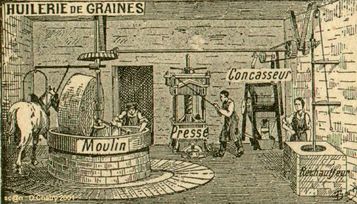
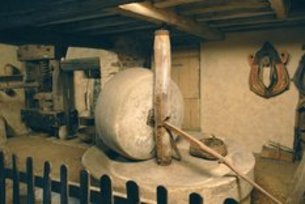


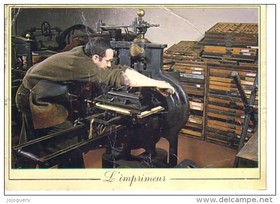

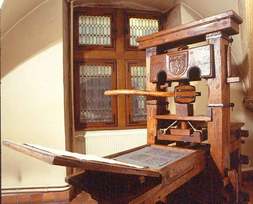







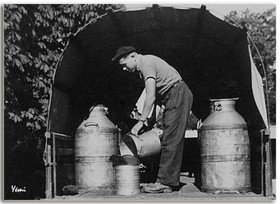

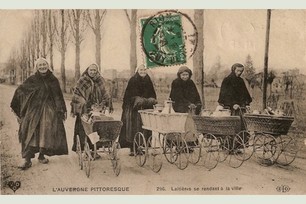





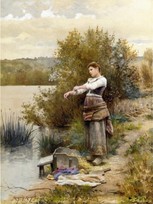


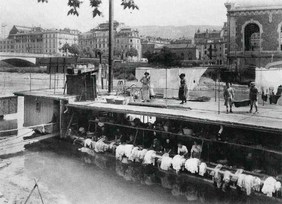















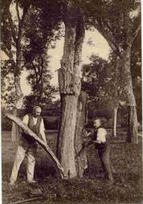


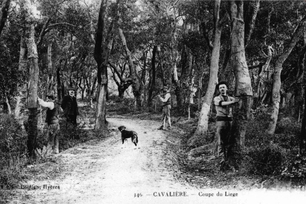
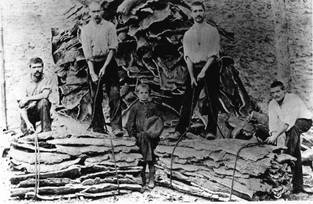
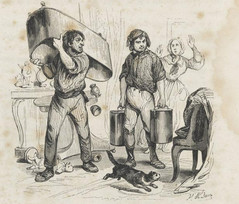
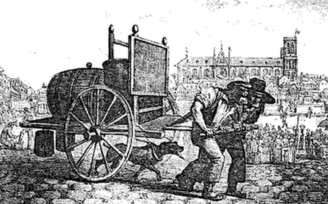
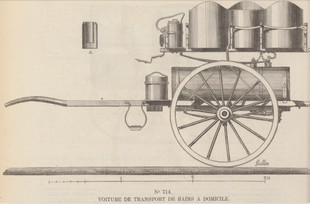



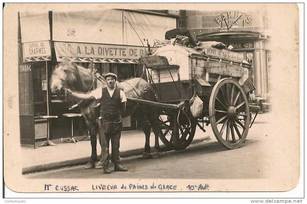
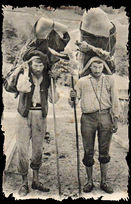

,_Mirecourt,_2013.jpg)
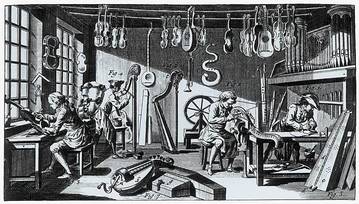
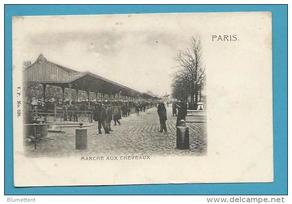
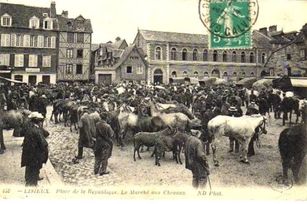
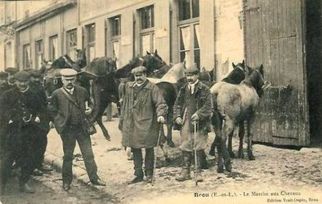
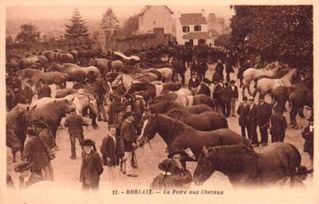
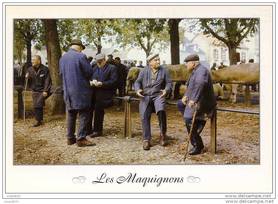
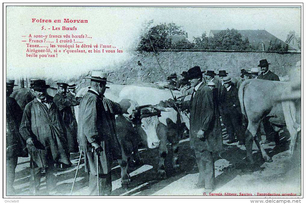


















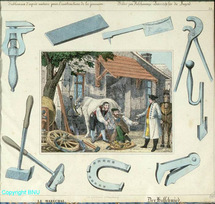





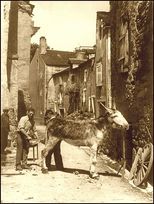


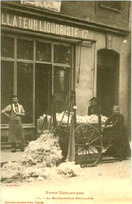

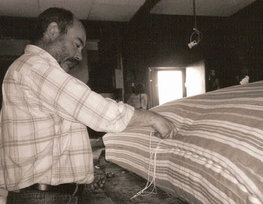

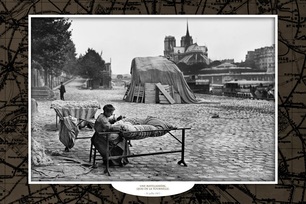

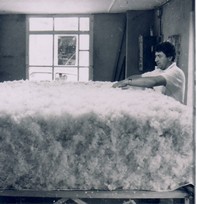



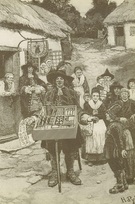


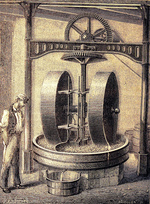


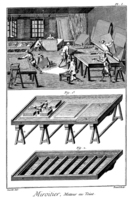



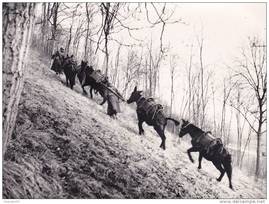
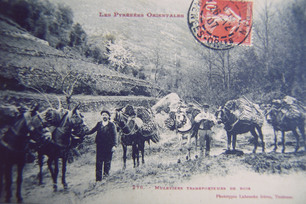
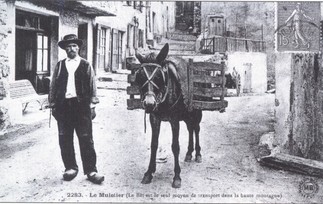
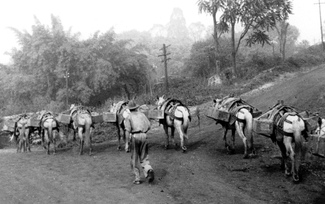














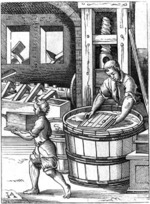




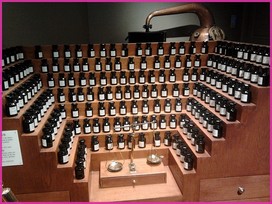


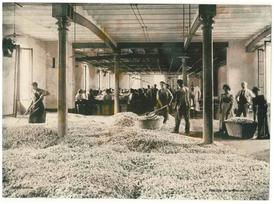



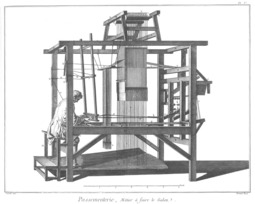



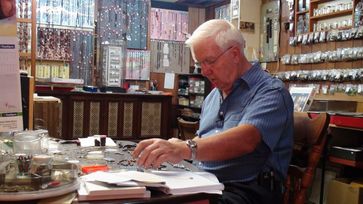










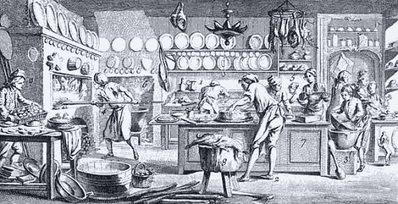




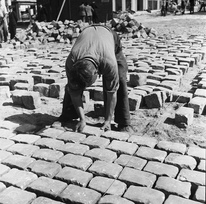





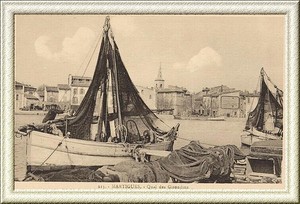
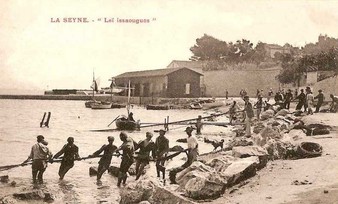
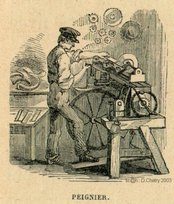
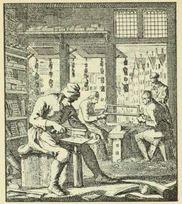





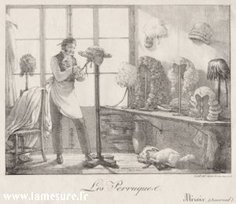



.jpg)